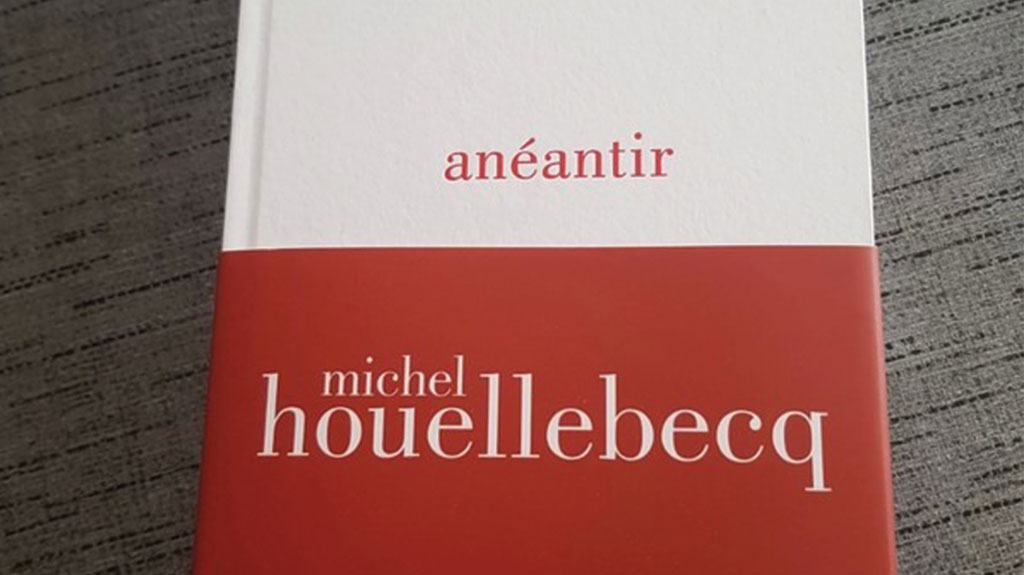Quand peinture et littérature s’unissent

Par Claire Boyer
Photo Claire Boyer
Publié le 3 novembre 2022
Vous le voyez ? Là, juste sur la couverture, à peine dévoilé par une déchirure en trompe-l’œil… Un petit oiseau jaune à l’aspect fragile, et en même temps dressé avec dignité, plein d’une vitalité contenue ? Et au-dessus, un titre laconique, sans fioritures : Le Chardonneret. Mystère, fatalité, art et illusion se mêlent dans le dernier roman de Donna Tartt, qui, après le succès du Maître des illusions et Le Petit copain, nous livre encore une œuvre magistrale, récompensée par le prix Pulitzer.
Automne et hiver approchent, le temps se refroidit, fini les lectures riantes des jours ensoleillés. Et plutôt que de se jeter bille en tête dans les sorties de la rentrée littéraire, pourquoi ne pas se laisser tenter par un beau pavé, bien intriguant : Le Chardonneret (publié en 2013), dont la lecture s’accordera à merveille aux matinées brumeuses et aux heures froides de la nouvelle saison ? L’autrice américaine, Donna Tartt, ne vous est peut-être pas inconnue : son premier roman, Le Maître des illusions (1992), sombre campus novel rappelant Le Cercle des poètes disparus, avait déjà été chaleureusement salué par la critique. Huit ans après son deuxième ouvrage, Le Petit copain (2004), la voici de retour dans une nouvelle narration encore plus dense et foisonnante.
Le récit d’une errance
Évènement crucial autour duquel se noue l’intégralité de l’intrigue ; tout débute par une explosion dans un musée new-yorkais. Encore à l’aube de l’adolescence, le jeune Theodore Decker voit alors le cours de sa vie basculer : sa mère, son seul véritable ancrage, décède dans l’attentat. Par un jeu de circonstances étranges, il se retrouve dès lors en possession d’un minuscule tableau de maître, Le Chardonneret, peint au XVIIe par le Hollandais Fabritius. L’ouvrage n’est cependant ni une enquête ni un policier : on suit l’errance forcée, puis la véritable descente aux enfers de Theodore, qui se retrouve livré à lui-même, en proie à la culpabilité, essayant de faire son deuil tout en masquant son lourd secret – la présence du tableau. C’est donc un roman compact, angoissant, l’intrigue aussi lourde que l’objet-livre, et dont on ressort tourneboulé·e, mal à l’aise, voire légèrement écœuré·e.
La fatalité et le désespoir semblent tissés ensemble : malgré ses tentatives, Theodore est sans cesse rattrapé par son passé et ne peut échapper à son destin. « Une explosion montre bien le caractère aléatoire de l’existence, et le terrorisme est devenu une part de la vie urbaine de nos jours », explique Donna Tartt dans une interview avec Le Point. La lenteur de l’action est au service de l’ambiance pesante et étouffante qui domine le texte : enfermé dans les émotions de Theodore, le·a lecteur·rice vit l’attentat, les rencontres, le refoulement des sentiments, la honte, la peur… À l’instar du malheureux Sisyphe, condamné à pousser pour l’éternité un énorme rocher au sommet d’une montagne, petit à petit, Theodore s’enferre dans le mensonge, tombe dans l’addiction, tout en essayant simplement de survivre…
Ainsi, l’ouvrage balaie la frontière entre le bien et le mal car implicitement, tout le livre questionne : jusqu’à quel point sommes-nous responsables de nos actions ? Emprisonné au sein d’un infernal cercle vicieux, jusqu’à la fin, il restera très difficile pour le·a lecteur·rice de blâmer Theodore.
Un style incomparable
L’ambiance pesante est néanmoins contrebalancée par quelques moments de bonheur, dont la rareté même ajoute à leur beauté, le tout accompagné d’une écriture envoûtante. De New York à Amsterdam, l’autrice dépeint avec succès des lieux hors du temps : une matinée pluvieuse à Manhattan, un soleil si violent et lumineux qu’il en devient malsain à Vegas, une boutique d’antiquités. « J’arrivais parfois à me calmer et à me rendormir en pensant à sa maison où, sans même s’en rendre compte, on se glissait parfois dans les années 1850, dans un monde d’horloges qui tictaquent et de lattes de parquet qui grincent, avec des marmites en cuivre et des paniers de navets et d’oignons dans la cuisine, sans parler des flammes de bougies penchant toutes vers la gauche sous l’effet du courant d’air d’une porte ouverte, de grandes baies ondulantes et gonflées comme des robes de bal, et des pièces fraîches et tranquilles où dormaient de vieilles choses » (p. 246).
Cette peinture des lieux s’applique aussi aux personnages : laissés-pour-compte, gamins errants, dealers et grande bourgeoisie sont décrits avec le même soin méticuleux, en quelques termes puissamment évocateurs. Une psychologie fine entoure chaque personne, dresse son physique comme son mental, et en de courtes descriptions la figure « naît », semble éclore au milieu des pages, non sans rappeler le style de Michael Ondaatje dans Ombres sur la Tamise. Et d’ailleurs, de nombreuses références, plus ou moins implicites, se cachent au creux des pages : des clins d’œil à certains classiques anglais du XIXe, mais aussi à Camus, Salinger ou Dostoïevski.
L’art, la rédemption
Enfin, comment parler du Chardonneret, sans évoquer le chardonneret ? L’œuvre semble bâtie tout entière sur cette mise en abyme du texte et de la peinture. Représentant un petit oiseau, dont la patte est tristement entravée par une chaînette, la reliant irrémédiablement au perchoir, le tableau existe réellement. Il a été réalisé par un élève de Rembrandt, Fabritius, qui semble avoir en retour considérablement influé sur l’œuvre de Vermeer. Mais surtout, Le Chardonneret est l’une des rares peintures à avoir réchappé à l’explosion de la poudrière de Delft, qui détruisit une grande partie de la ville en 1654.
Les parallèles entre l’histoire du tableau et celle du livre sautent aux yeux : le Chardonneret est quasiment le second personnage du roman. Miroir de la position de Theodore tout au long du récit (captif des évènements et dans l’incapacité de fuir), cette peinture, et l’art en général, vont paradoxalement lui permettre de surmonter les épreuves. Car si l’ouvrage se garde de tout jugement, il offre tout de même un encouragement, une note d’espoir : se tourner vers l’art peut sauver la vie. « Et tout comme la musique et l’espace entre les notes, tout comme les étoiles resplendissent à cause du noir qui les sépare, tout comme le soleil frappe les gouttes d’eau à un certain angle et envoie un prisme coloré traverser le ciel – l’espace où j’existe, et où je veux continuer d’exister (…) est exactement cette distance intermédiaire : là où le désespoir a heurté la pure altérité et créé quelque chose de sublime. » (p. 1099).
Il y a des œuvres d’art qui sont importantes, mais qui ne vous parleront jamais
Donna Tartt
Donna Tartt défend l’idée d’une résonance particulière de chaque individu avec une œuvre, quelle qu’elle soit. « Il y a des œuvres d’art qui sont importantes, mais qui ne vous parleront jamais » dit-elle dans l’interview. Au contraire, d’autres provoquent en nous des réactions immédiates : qui n’a jamais été profondément ému·e devant un tableau particulier, à l’écoute d’une certaine musique, alors même que notre entourage ne remarque rien de spécial ? C’est une ode à ces dialogues rapports intimes, profonds, entre un artiste et un individu par le biais de l’œuvre, que constitue in fine Le Chardonneret.
Pour conclure, lisez ce qu’en disent les auteur·ices et la presse : « une rareté qui ne se produit peut-être qu’une demi-douzaine de fois par décennie » (Stephen King), « Un livre intelligent qui parle à la fois au cœur et à l’esprit » (New York Times). Sans multiplier les éloges, il est certain que l’univers du Chardonneret fait partie de ceux qui continueront pour longtemps de hanter ses lecteur·ices.