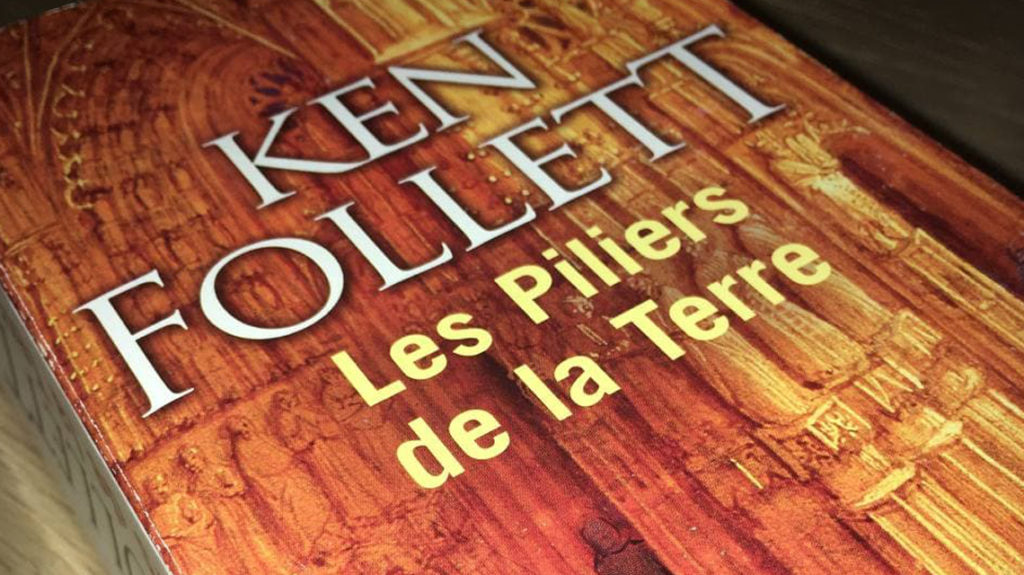Quand Alpha devient Bêta

Par Madeleine Gerber
Photo DR
Publié le 19 août 2025
Point positif : Alpha parle d’une jeune fille et pas de mascu. Point négatif : c’est pas très bien. Dans une dystopie pas si éloignée de notre réalité (il y a encore des cours de piscine au collège), une épidémie transforme les contaminé·es en sculpture de marbre. Ce FX et l’affiche rouge du film sont les plus grandes réussites du long-métrage de Julia Ducournau. Celle qui avait gagné la palme d’or avec l’excellent Titane en 2021, et mon cœur avec son premier film Grave (2016), repart bredouille (et à raison) de la compétition cannoise cette année.
L’erreur est humaine. Surtout avec une pression monumentale qui suit deux succès cinématographiques. En tout cas, Alpha a tout d’une sortie de route, tant du point de vue esthétique que scénaristique. L’on se demande même si ce n’est pas Maes sous Omerta 47 qui aurait laissé passer le film en sélection officielle. Quand on a des yeux et des oreilles, on agit en bon·ne citoyen·ne en évitant l’humiliation à la réalisatrice et la déception au public. Face à l’accueil plutôt catastrophique du film, Ducournau reste de marbre (haha), préférant des réactions négatives à pas de réaction du tout.
Laideur
J’ai été choquée d’apprendre, en écrivant cet article, que le film avait reçu le prix CST de l’artiste technicien (Commission supérieure technique de l’image et du son) pour Ruben Impens, directeur de la photographie. Ici, je crois faire parler l’objectivité en décriant l’image du film. Si vous regardez ne serait-ce que l’affiche aux tons bruns qui sert à la communication du film, vous sentez que quelque chose ne va pas. Dites-vous que cette photographie est à l’image de 50% du film, dans les parties du « temps présent ». Les couleurs, la texture, la lumière ; tout donne envie de se détourner. On dirait une miniature de film de piètre qualité disponible en entier et en VF sur YouTube.
La pauvre Mélissa Boros semble avoir dévoré l’intégralité des ateliers de poteries du XIe arrondissement. Et si l’envolée de quelques mèches rappelle la Vénus de Botticelli, la comparaison s’arrête bien là, avec un visage affreusement emplâtré qui n’a pas d’égal sur le TikTok anglais. Ça fait sale, mais à la fois trop travaillé. Un sale de cinéma qui n’appelle ni réalisme, ni science-fiction réussie. Une laideur bâtarde, d’entredeux, qui n’est pas digne du grand écran.
Ghost writer (je crois que Ducournau nous a abandonné·es en cours de route)
Sans aucun doute, beaucoup d’étudiant·es au cinéma écrivent de meilleurs scénarios que celui-là. En tout cas, si un tel travail avait été rendu à l’école des arts de la Sorbonne, l’auteur·ice en serait ressorti·e avec un 4/20, des rêves brisés et une sévère dépression. Ici, allers et retours entre passé et présent s’entremêlent, sûrement pour dynamiser davantage le film, mais cela ne fait que nous perdre davantage. (Heureusement que les protagonistes changent de coupe de cheveux entre, sinon on ne s’en sortirait pas). Sans parler de la fin qui se veut « libre », mais on finit par en avoir marre d’écrire nous-même le scénario surtout quand le reste de l’histoire est bâtie sur du sable.
On ne s’attardera pas sur le remake des années sida, entre ce prof gay humilié par ses propres élèves et les superstitions autour de la contamination par les fluides. Ni sur l’attachement inexplicable d’Adrien pour Alpha et leurs premiers émois amoureux qu’on aurait bien voulu s’épargner.
Emma Mackey ?
Je ne sais pas trop à quoi l’actrice a servi, à part à la montée des marches pendant le festival. On la voit très peu, dans un rôle si accessoire qu’on se demande s’il n’a pas été victime de coupes au montage. Ce court paragraphe lui est dédié.
Qu’est-ce qu’on sauve ?
La scène d’introduction avec la constellation sur le bras de Tahar Rahim. La scène de la piscine qui rappelle que Julia Ducournau faisait dans l’horreur. Tahar Rahim (qui fait très peur). Tahar Rahim (qui est touchant). L’investissement de Golshifteh Farahani dans son rôle de femme puissante. Tahar Rahim (dans Un prophète de Jacques Audiard). Le faux tatouage qui sent l’infection à des kilomètres. Et Tahar Rahim.