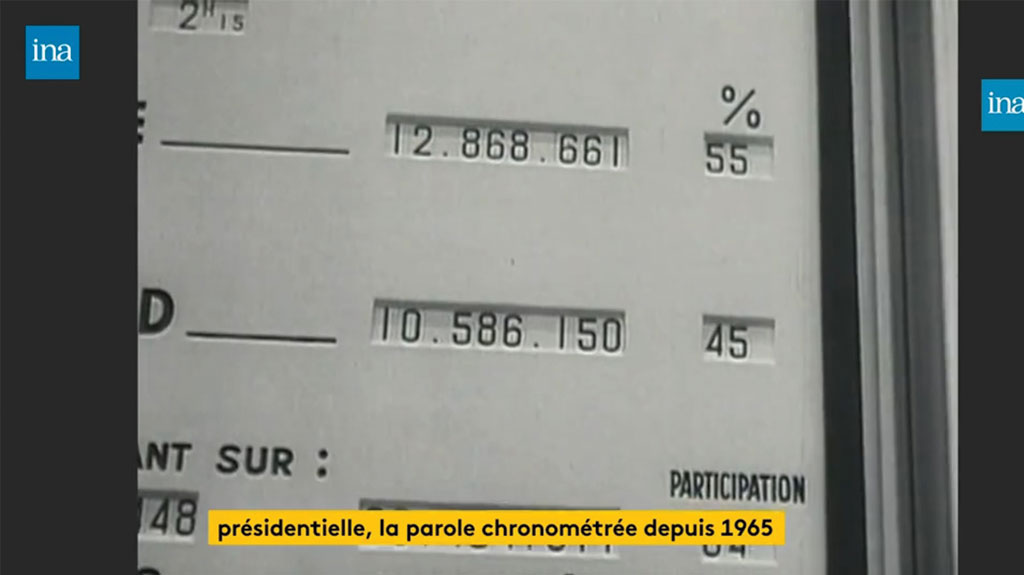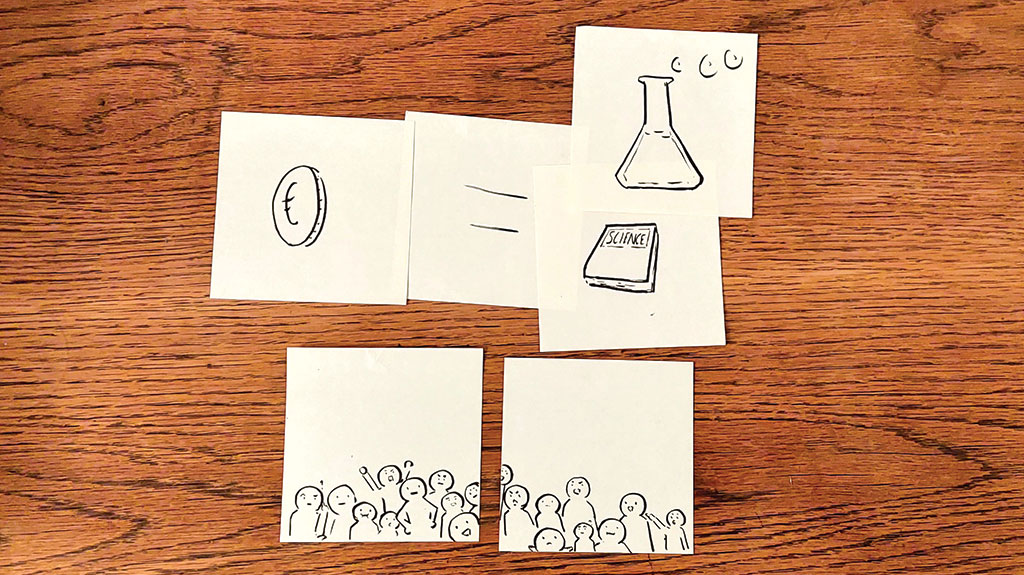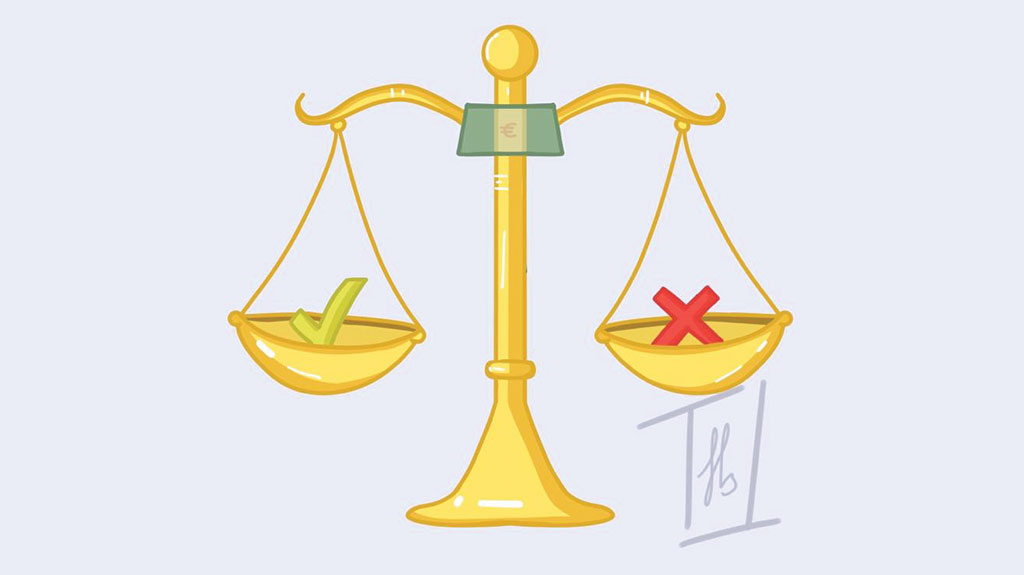Le Triangle d’or : triangle de tous les vices ?

Par Clara Pegard
Photo ©Canva
Publié le 13 mai 2025
Le Triangle d’Or, région d’Asie du Sud-Est, qui marque l’histoire depuis le XIXe siècle, du fait de ses travers mafieux, semble aujourd’hui être tombée dans l’oubli. Cependant, si cette zone semble faire moins de remous que jadis, cela ne signifie pas pour autant que ses activités illégales se sont taries.
Ces dernières se sont en réalité transformées afin de répondre aux besoins contemporains, tout en prenant en compte certains facteurs. Effectivement, la culture du pavot qui constituait la part essentielle de son activité il y a encore trente ans est passée au second plan, du fait de la concurrence menée par le croissant d’or en la matière (Afghanistan, Iran, Pakistan), depuis les années 2000.
Il n’en reste pas moins que cette région, bordée par le fleuve Mékong et la rivière Ruak, à la jonction de trois pays (Thaïlande, Laos et Myanmar), jouit d’un emplacement de choix pour envisager de nouvelles activités. Elle bénéficie également d’un statut de ZES (zone économique spéciale), ce qui renvoie à une zone géographique délimitée dans laquelle les politiques fiscales et économiques sont mises en œuvre de telle sorte à favoriser le développement, attirer les investissements d’entreprises… Les trois pays de la région en tirent des avantages au regard de nouvelles infrastructures modernisées qui favorisent les investissements dans des secteurs de reconversion ciblant l’industrie, l’agriculture, l’exploitation de bois et de pierre précieuses ou encore le tourisme.
Nonobstant, le Triangle d’Or semble répondre à la théorie économique de path dependance : un pays ou une région – lorsqu’il ou elle innove, reste fortement influencé·e par ses activités passées et ne peut opérer un changement franc. D’un côté, la région peine à se défaire de la fabrication de stupéfiants dans la mesure où certaines ethnies comme les Hmongs les cultivent de manière ancestrale, mais aussi car elle s’est reconvertie dans les drogues de synthèse bon marché. Pour preuve, des saisies impressionnantes ont toujours lieu : en octobre 2021, plus de 55 millions de pilules de méthamphétamine ont été saisies au Laos.
Cela n’empêche pas la région de concentrer d’autres activités mafieuses : les casinos et complexes hôteliers sont les temples du blanchiment d’argent, et la prostitution est également un autre fléau – particulièrement à la tombée de la nuit. Néanmoins, plus récemment, on note l’essor d’une activité nouvelle qui n’est pas pour autant plus vertueuse : la cyberfraude. Des individus des quatre coins du monde sont attiré·es dans un piège : l’emploi lucratif promis consiste finalement en la pratique de cette arnaque, parfois grâce à la technique du Pig Butchering, et ce dans des conditions de travail déplorables et sans aucun respect des droits fondamentaux.
En conséquence, un contrôle tente de s’affirmer à plusieurs niveaux en vue d’essayer d’endiguer ces multiples fléaux. Certains pays comme la Thaïlande envisagent d’étoffer leur droit interne, comme le montre le décret d’urgence pensé pour combattre la cybercriminalité. De plus, une coopération entre des pays voisins a pu voir le jour, notamment entre le Laos et le Vietnam.
Le mécanisme le plus probant reste international, puisqu’un nombre croissant de postes de l’ONUDC sont créés au niveau des points chauds, visant à intercepter notamment les convois de produits illicites avec des appareils à rayon X.
Finalement, un regard pessimiste peut certes être porté sur l’efficacité de ce contrôle mais soulève aussi des questions quant à l’avenir de cette région. Ces pays tiraillés par des injonctions contradictoires, sont tant sous le joug de la mafia locale, que de l’État central lorsque celui-ci n’est pas failli. Cette situation épineuse semble se rapprocher de celle de la triple frontière en Amérique du Sud, au sein de laquelle les activités criminelles et de contrebande prospèrent.