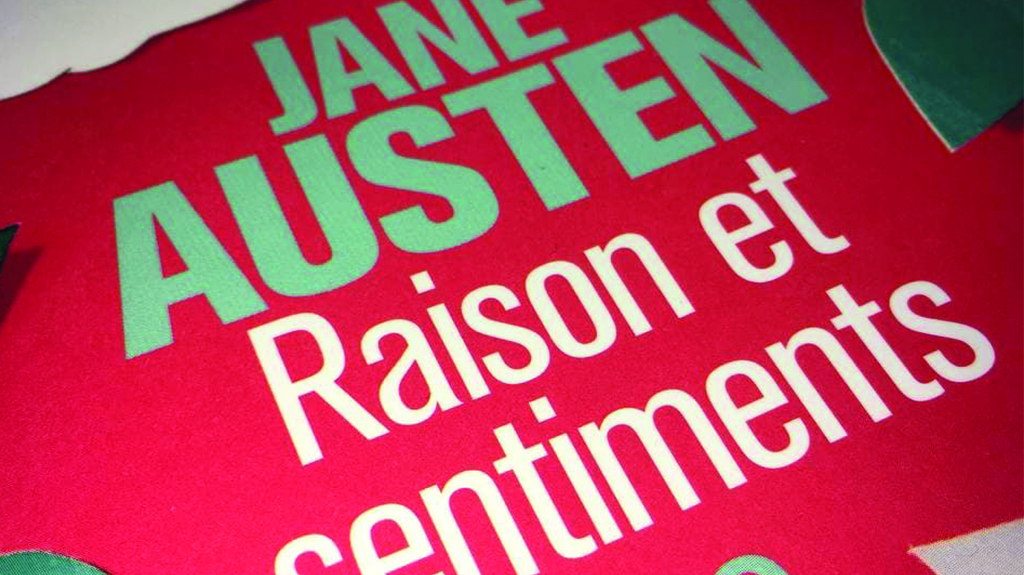Les Nuits Blanches
Par Léa Amara
Illustration ©Luchino Visconti, photogramme des Nuits blanches, 1957
Publié le 2 mai 2025
Pourquoi, dans un monde où nous sommes entouré·es d’une multitude de personnes, ressentons-nous une telle solitude qui nous pousse à vivre en marge de la société ? Quelques réflexions nocturnes avec Dostoïevski.
Le rêve d’une existence pleine de sens et d’épanouissement est une quête humaine universelle, mais souvent entravée par la peur de vivre pleinement le moment présent. On se réfugie donc, par second ressort, dans la nostalgie et la mélancolie pour pouvoir revivre ces moments passés, mais manqués. Les Nuits Blanches (1848), œuvre emblématique de Fiodor Dostoïevski, présente, à travers un personnage profondément mélancolique, la réalité où se confondent les rêves et les espoirs illusoires. Ce personnage sans nom est un homme solitaire et rêveur, plongé dans ses pensées nocturnes, et incarne un reflet des tourments de l’âme humaine, confrontée à l’aliénation et à la nostalgie. Cette expérience de solitude dans une ville vibrante et peuplée, fait résonner des échos dans notre époque contemporaine, où de nombreux·euses jeunes étudiant·es, ainsi que des cadres ou fonctionnaires, se retrouvent piégé·es dans une réalité similaire.
Un fantôme parmi les vivant·es
Le protagoniste des Nuits Blanches évolue dans un décor urbain animé, mais il reste sciemment invisible, un fantôme parmi la foule. Sa solitude est exacerbée par son observation passive du monde qui l’entoure ; il est un témoin de la vie des autres sans jamais en faire partie. Cette expérience bidimensionnelle, où il oscille entre le rêve et la réalité, reflète la réalité d’un grand nombre de jeunes aujourd’hui. Dans les grandes villes, on côtoie des milliers de personnes chaque jour, sans établir de véritables connexions humaines, créant ainsi une distanciation émotionnelle.
Nombreux·euses sont celles et eux qui, en tant qu’étudiant·es ou jeunes professionnel·les, vivent cette même solitude : se déplacer en métro bondé aux heures de pointe, lorsque le RER A est supprimé, travailler dans des bureaux où les conversations se limitent à des échanges superficiels, ou se retrouver dans des lieux publics remplis de gens, mais où l’isolement est palpable. La peur d’être réellement connu·e ou de s’exposer aux autres, peut paralyser l’initiative de tisser des liens significatifs, alimentant ce sentiment de fantôme moderne.
La rêverie
Le protagoniste des Nuits Blanches est un homme anonyme, dont la vie est caractérisée par une profonde solitude. Errant dans les rues de Saint-Pétersbourg, il observe les passant·es sans jamais vraiment les rejoindre. Sa condition de rêveur obsessionnel emprisonne ses pensées dans un cycle de mélancolie et d’aspirations. Ce personnage incarne une forme de désespoir créatif, où les rêves d’un amour inaccessible nourrissent son imagination. Il est facilement identifiable comme un idéaliste, capable de percevoir la beauté dans les petites choses, mais aussi de se perdre dans l’inaction. Ces traits de caractère résonnent profondément avec notre génération contemporaine. Dans une ère marquée par le numérique et les relations virtuelles, beaucoup se sentent isolé·es malgré des connexions prétendument omniprésentes. Le protagoniste de Dostoïevski, en dépit de son environnement, ne trouve pas sa place dans le monde. En effet, le personnage se présente comme un fonctionnaire timide qui a du mal à trouver sa place dans une société qui tourne petit à petit vers le capitalisme naissant de l’époque. Cette sensation d’aliénation se manifeste aujourd’hui, où la superficialité des interactions en ligne peut exacerber le sentiment de solitude.
Les rêves du protagoniste reflètent une quête désespérée d’amour et de validation. Lorsqu’il rencontre Nastenka, une jeune femme pleine d’espoir et de promesses, il projette tous ses désirs refoulés sur elle. Cette relation naissante symbolise l’évasion du vide existentiel, mais également l’angoisse de l’inaccessibilité. Au fur et à mesure que Nastenka partage ses propres aspirations et désirs, le narrateur est confronté à l’inadéquation de ses propres rêves. Cette quête de rêve, que ce soit à travers l’amour ou la réalisation personnelle, trouve un écho dans les aspirations de notre génération d’aujourd’hui. Beaucoup ressentent une pression intense pour réussir rapidement, tout en poursuivant des idéaux souvent irréalistes. Comme le protagoniste, iels peuvent se retrouver à idéaliser des relations ou des succès qui semblent inaccessibles, tout en se sentant piégé·es dans une réalité qu’iels perçoivent comme insatisfaisante. L’angoisse de rater des occasions de vivre pleinement, accentuée par le succès des autres, mis en avant sur les réseaux sociaux, intensifie ce sentiment de malaise.
Passer à côté de sa vie
La thématique centrale des Nuits Blanches est l’angoisse de vivre une vie peu remplie. Le protagoniste se présente comme un homme qui, dans ses nuits blanches, se rend compte qu’il a laissé passer des opportunités, par peur d’agir. Ce dilemme existentiel est amplifié par le contraste entre ses rêves romantiques et son incapacité à les concrétiser. Dans notre société moderne, cette situation résonne avec la peur omniprésente de ne pas « accomplir » les choses. Le récit de Dostoïevski fait écho aux préoccupations de notre génération qui, à l’ère de l’information et de la surstimulation, se bat contre le sentiment d’inadéquation et de procrastination. Les défis pour prendre des décisions significatives ou réussir à construire des relations authentiques sont amplifiés par la comparaison constante avec les autres, souvent idéalisée par le prisme des réseaux sociaux.
Pour comprendre cette peur de vivre, il est pertinent de se tourner vers les penseurs tels qu’Épicure et Jean-Paul Sartre. Épicure, dans sa quête de la vie heureuse, souligne l’importance de vivre le moment présent et de se libérer de la peur de la mort. Pour lui, la crainte de l’inconnu et des conséquences futures peut paralyser l’esprit et empêcher l’individu de profiter des plaisirs simples de la vie. Dans Les Nuits Blanches, le protagoniste incarne cette peur, étant incapable d’agir et de saisir les opportunités qui se présentent à lui. Ses nuits blanches témoignent de son incapacité à vivre le présent, le forçant à s’enfermer dans un monde de rêves inaccessibles.
Sartre, quant à lui, évoque l’angoisse existentielle qui découle de la liberté humaine. Dans L’Être et le Néant, il affirme que la prise de conscience de notre liberté peut engendrer une peur paralysante, car elle oblige l’individu à faire des choix. Cette angoisse de la liberté empêche le protagoniste de Dostoïevski d’accéder à une vie authentique, le poussant à la procrastination et à la nostalgie, des sentiments qui le maintiennent dans une boucle infinie d’évitement. La liberté est à la fois un don et un fardeau ; la prise de conscience de cette liberté nous pousse à faire des choix, mais engendre également l’angoisse. Nos protagonistes modernes, que ce soit un·e étudiant·e à l’université ou un·e fonctionnaire dans une métropole, peuvent se sentir accablé·es par la pression de devoir réussir, entre enregistrements de performance et attentes sociales.
La nostalgie, refuge illusoire
La nostalgie peut être définie comme un sentiment mélancolique lié à une époque révolue, souvent perçue comme plus joyeuse ou simple que le présent. Dans l’œuvre de Dostoïevski, le protagoniste se réfugie dans ses souvenirs et ses rêves d’un amour idéal, ce qui illustre comment la nostalgie peut servir d’échappatoire face aux incertitudes du présent. Cela peut conférer un sentiment temporaire de bonheur, mais empêche la véritable croissance personnelle. Le besoin de se retirer dans un monde rêvé est le reflet de notre génération face à la réalité souvent décevante et pressurisée de la vie moderne. S’asseoir seul·e dans une cafétéria bruyante, se remémorer peut-être des moments d’innocence et de simplicité, se réfugier dans la nostalgie pour échapper à l’anxiété du présent est l’exutoire le plus simple.
La nostalgie devient ainsi une échappatoire, mais aussi un piège. En s’accrochant à des souvenirs idéalisés, nous perdons de vue la beauté potentielle de l’instant présent. Cela soulève une autre dimension de la problématique : comment trouver la motivation pour établir des relations authentiques et vivre pleinement, lorsque l’évasion semble plus facile que l’engagement dans la réalité ?