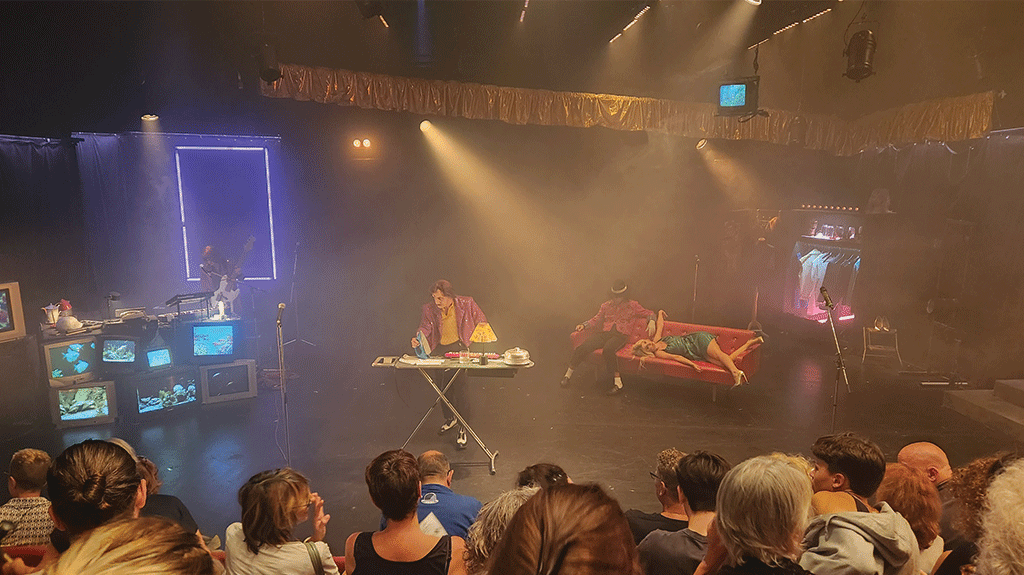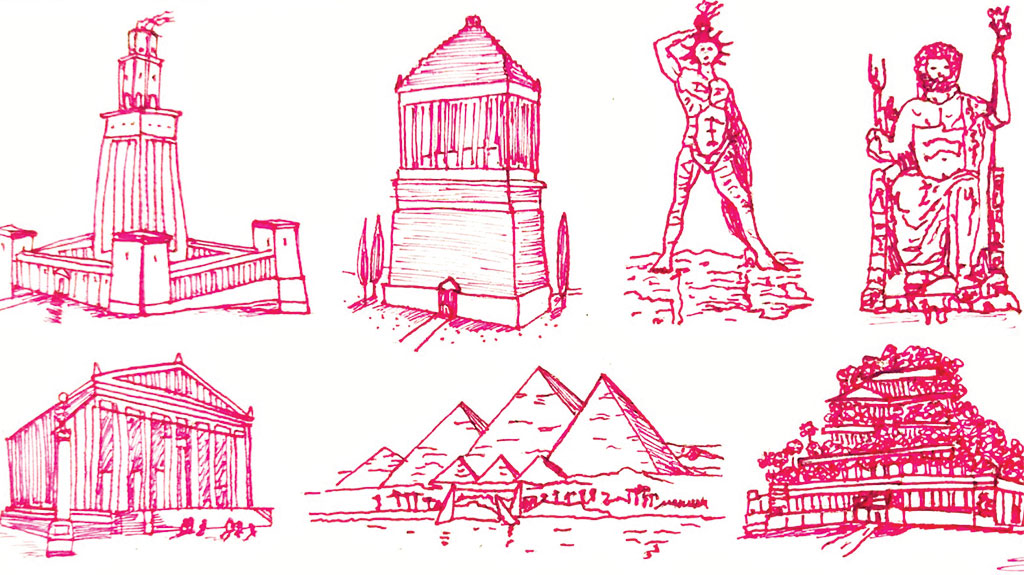Matisse, l’art et le commerce

Par Macha Grand
Illustration Macha Grand
Publié le 19 septembre 2024
Entre le 4 mai et le 9 septembre 2024, c’est Matisse qui était à l’honneur à la Fondation Louis Vuitton à travers le prisme de son Atelier rouge. Cette œuvre, autrefois incomprise, fait maintenant date dans l’histoire de la peinture. On vous dresse le tableau !
C’est une petite exposition, comme si l’on voulait compenser la monumentalité de la précédente. La dernière, interminable et s’étalant sur trois étages, semblait faire de la fondation LVMH l’inattendu grossiste de Mark Rothko. D’habitude, c’est plutôt une relation intimiste qui est créée avec les toiles de cet artiste, dans le calme d’une Rothko Chapel par exemple. C’est pourtant bien la même curatrice, également directrice de la fondation, Suzanne Pagé, qui a pris sous son aile l’installation de l’exposition Matisse, L’Atelier rouge dans une approche bien différente.

Les invendus au mur
En entrant dans la salle clé de l’exposition, le spectateur se retrouve comme plongé à l’intérieur du tableau L’Atelier rouge. Ce dernier, emmuré et monochrome dans un envoûtant rouge vénitien, laisse à peine les contours blancs de certains meubles évoquer une présence au sein de l’atelier. Dans ce grand vide, un peu partout apparaissent des tableaux : Matisse s’amuse à repeindre ses anciennes œuvres. Pour contextualiser, cette toile fut peinte en 1911 et représente l’atelier de Matisse d’Issy-les-Moulineaux. À cette date, le fameux mécène et collectionneur russe Sergueï Chtchoukine est déjà passé par là et l’artiste a également exposé. De ce fait, que reste-t-il à l’atelier alors que Matisse est dévalisé par les salons et le mécénat ?
Les invendus ainsi que les œuvres non exposées provoquent pour nous une véritable inversion et deviennent le centre de notre attention picturale. L’auteur joue à inverser notre perspective. Il représente là ses premiers tableaux, marqués de son amour pour la couleur violette. Il y a là ses tableaux plus expérimentaux, peut-être moins compris de ses contemporains. Il y a même ses sculptures. Au premier plan, cependant, c’est une assiette qui nous accueille et envahit le regard, comme pour affirmer une abolition des grandeurs et des hiérarchies des formes. Derrière elle seulement, et en plus petit, est dépeint Le Luxe (II), un grand format en pied qui fut exposé à l’Armory Show en 1913.
Atelier (dé)commandé
Dans la salle d’exposition parisienne, le·a spectateur·ice se retrouve face à face avec toutes ces œuvres physiques. D’abord peintes, repeintes, et maintenant rapportées par la fondation de différentes collections françaises et de l’étranger, elles sont érigées autour du « chef-d’œuvre » L’Atelier rouge. Nous-mêmes, pris·es dans cette extension tentaculaire de l’atelier de l’artiste, une question nous vient à l’esprit : pourquoi nous montre-t-on ce tableau d’abord plutôt qu’un autre ? La priorité de ce tableau ne nous semble pas évidente lorsqu’on prend acte de son histoire : L’Atelier rouge fut peint dans le cadre d’une commande du plus grand acheteur de Matisse, Chtchoukine. Néanmoins, celui-ci refusa d’acheter la toile lorsqu’il la vit. À la suite de cela, elle passa lentement de main en main jusqu’au Gargoyle Club londonien, avant d’être finalement repérée par Alfred Barr, alors directeur du MoMa, dans ce qui semble être un coup de chance, ou bien un caprice de la fortune.
Aujourd’hui, la Fondation Louis Vuitton, en partenariat avec le MoMA, est l’autorité qui détient le pouvoir de qualifier L’Atelier rouge de « chef-d’œuvre ». Sous l’égide d’une ambition historiciste, l’utilisation même de ce mot fige l’œuvre dans une interprétation rigide, dictée par l’autorité institutionnelle.
Trace rouge
En recouvrant sa toile de rouge d’un geste rapide et audacieux, qu’on dit fait en une heure avant la finition, Matisse marque une rupture avec ses travaux passés. En effet, il refuse ainsi l’académisme qu’il apprit chez Moreau pour se plonger dans un début d’abstraction pure où la couleur devient totale. Loin d’être mû par une propagande personnelle, la marque principale de ce tableau – une tache vide et rouge en son centre – fait de l’œuvre une sorte d’incantation silencieuse qui, si elle pouvait parler, n’aurait rien à dire et couperait court avant l’arrivée du mot. L’artiste est alors, par définition, celui qui montre ce qui ne peut pas encore être dit.
Le léger malaise que certain·es auront pu ressentir en sortant si vite de cette petite exposition s’expliquerait sûrement par un plaidoyer humaniste. Ce qui semble nous tirailler est cet écart incessant entre l’art qui est « geste » – sacré, irréductible et dépouillé de l’attente de tout retour matériel, à l’instar des fresques de Lascaux – et l’art qui se doit d’être « objet », nécessitant en cela un espace d’exposition (se faisant donc dans un système institutionnel et ritualisé).
Des facteurs divers, depuis la sélection rigoureuse des œuvres exposées, le travail de recherche, jusqu’à la rédaction de cartels, créent un art dont l’accès devient une forme de privilège, réservé à une élite qui peut se permettre de consommer ces expériences.
Plus qu’une revendication sociale, le besoin humain de dépasser la quotidienneté de l’utile se traduit dans notre désir d’un accès direct et gratuit à l’art. Ce besoin serait, comme George Bataille le décrit dans son livre L’Érotisme : « une faim insatiable – une gorge déployée prête à avaler l’univers. »