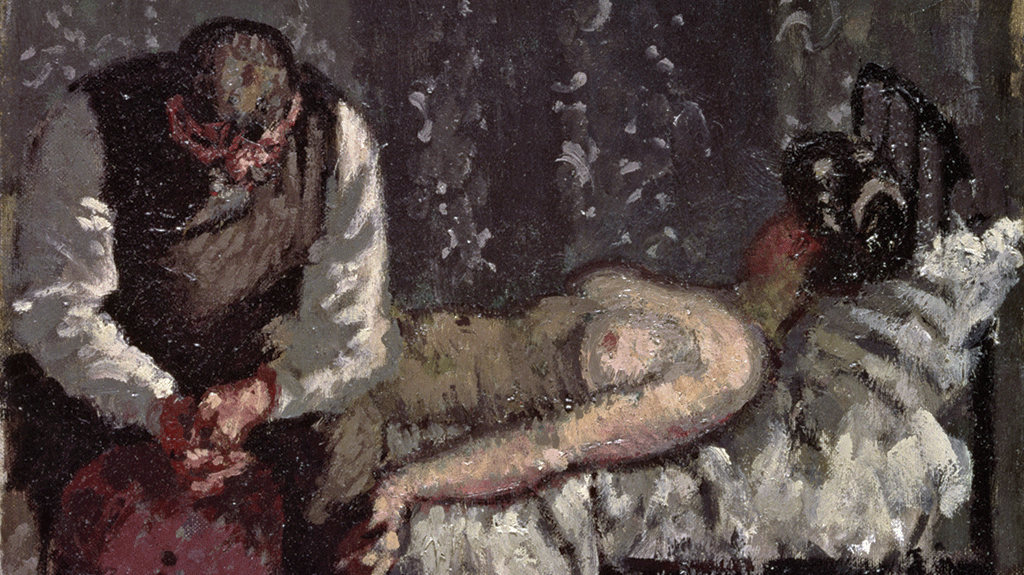Les musées peuvent-ils ouvrir leurs portes ?

Par Julia Mouton
Illustration @valartyn
Publié le 2 novembre 2023
Dans une publication TikTok datant du 2 octobre dernier[1], le service de communication du palais de Tokyo évoque le sentiment d’exclusion qu’une certaine partie du public peut ressentir face à l’art contemporain, parfois hautement abstrait. La solution proposée serait alors la présence de médiateur·ices culturel·les. Mais ceux où celles-ci ne se seraient·iels pas considéré·es plutôt comme les pansements d’une plaie plus profonde?
Il est souvent reproché à l’art, notamment dans ses formes les plus contemporaines, d’être élitiste. Et pour cause, tout le monde n’a pas les outils nécessaires à son appréhension. En effet, la possession d’un capital culturel plus ou moins important, étroitement liée à la domination sociale, s’exprime entre autres par un accès différencié à l’art.
S’agit-il alors de blâmer les parents qui n’emmènent pas leurs enfants au musée ? Ce serait là une considération bien limitée. De nombreux critères, comme ceux économiques et sociaux, entrent en ligne de compte pour se rendre dans des espaces culturels institutionnels et valorisés tels que les musées (mais l’on pourrait aussi parler des opéras ou des théâtres).
Devons-nous alors nous résoudre à renoncer à toute pratique artistique pouvant mener à l’exclusion ? Cela semblerait restreindre le champ des possibles de manière exponentielle, étant donné que même le rap devient l’apanage des nouvelles générations de la bourgeoisie…
Cet article se propose d’envisager une pratique de l’art consciente des enjeux qu’il couvre. Il permet également d’explorer les diverses solutions qui s’offrent à quiconque veut penser l’art comme iel l’entend. Nous dresserons une liste non exhaustive de plusieurs « réformes » envisageables, en essayant de mettre en lumière leurs limites. Il ne s’agit pas ici d’un travail visant à expliquer l’intégralité du système de discriminations entrant en jeu dans le milieu de l’art. En effet, ces pratiques sont extrêmement diverses et les oppressions multiplement imbriquées. Il s’agira plutôt de réfléchir, sur la base d’expériences vécues d’expositions, à l’écart persistant entre l’art et une partie de la population, ainsi qu’aux manières de construire un pont.
Il me semble important de préciser le point de vue duquel j’écris, car il est essentiel à ma compréhension de l’art. Mon parcours universitaire ne relève pas d’études artistiques, mais j’ai été sensibilisée assez tôt à l’art et je me rends assez fréquemment dans des espaces qui y sont dédiés. Ma compréhension de l’art est donc plus personnelle que « professionnelle » ou « technique ». Cependant, je ne peux pas pour autant m’exprimer au nom des personnes qui subissent le plus brutalement les pratiques d’exclusion sociale exercées par ces milieux.
Il est également important de délimiter notre étude : il s’agira ici de traiter de l’art « matériel », dont la présence physique ou visuelle est nécessaire et qui requiert un espace attribué. Par ailleurs, nous nous concentrerons sur l’art institutionnellement valorisé et reconnu comme « digne », à l’instar de la peinture ou de la sculpture qui sont mises en avant dans les musées traditionnels. Les pratiques de l’art dont la reconnaissance en tant que telle est plus récente, voire partielle (comme le street art ou les graffitis) mériteraient d’être abordées spécifiquement. En effet, elles soulèvent des problématiques différentes, telles que celle de l’embourgeoisement.
1. Un choix d’artistes plus inclusif
Il semble que l’un des réflexes à privilégier, de la part des curateur·ices notamment, serait de se diriger vers les artistes les moins visibles au sein des institutions.
A titre d’exemple, nous pouvons mentionner l’exposition ayant eu lieu du 3 juillet au 6 novembre 2022 à la fondation Cartier pour l’art contemporain. Mirdidingkingathi Juwarnda Sally Gabori, artiste aborigène appartenant au peuple kaiadilt, qui a commencé à peindre vers l’âge de 80 ans, se voit consacrer l’intégralité du site (excepté les jardins). Ses œuvres sont exposées sans laisser de côté leur dimension symbolique, mettant en avant son peuple, son île natale (île Bentinck), ainsi que les persécutions vécues suite à leur exil.


Reste que la seule exposition de l’artiste ne peut suffire à ouvrir les portes du monde de l’art. L’inégalité n’en est que renforcée : il n’est pas demandé aux hommes blancs d’incarner la présence artistique et de faire de l’art pour tous les hommes blancs.
La responsabilité est en effet immense, d’autant plus qu’un groupe n’est jamais uniforme. Par exemple, l’expérience d’une femme noire lesbienne d’une trentaine d’années résidant à Paris est différente de celle d’une femme noire hétérosexuelle d’une soixantaine d’années résidant en milieu rural. Bien qu’elles aient des points communs, elles ne seront pas nécessairement touchées ou intéressées par les mêmes œuvres.
Ainsi, dans notre perspective, laisser la place à des artistes dont les positions sociales sont minorisées est essentiel, dans la mesure où l’on ne peut prétendre ouvrir les musées à un public tout en l’empêchant de s’y installer.
Cependant, cela est insuffisant, car on ne peut leur remettre le devoir de rendre l’art accessible, faisant de leur art celui qui doit être « l’art du peuple » face à un art bourgeois qui resterait confortablement dans son siège.
2. Jeter l’art par les fenêtres
En tant que lieu bien déterminé, le musée semble en lui-même être exclusif. D’abord, l’entrée est souvent payante. Des alternatives sont parfois apportées : on peut penser, par exemple, au Pass Jeunes mis en place par la ville de Paris et le département de la Seine-Saint-Denis durant la période estivale, qui permet d’accéder à de nombreux espaces culturels gratuitement.
La question de la localisation peut aussi être à retravailler. À ce titre, lors d’une interview au sujet de l’art et de son accessibilité[2] , Vera Kempf, co-fondatrice de Singulart (galerie d’art en ligne), met en avant le passage au numérique, permettant à tous·tes ceux ou celles qui le souhaitent d’accéder à l’art sans se déplacer.
Reste que, au-delà de ces paramètres « techniques », persiste un sentiment d’illégitimité au sein des classes sociales les moins privilégiées. Le milieu de l’art est effectivement régit de codes dont l’enseignement est témoin et renfort des inégalités. Les initié·es répondent à ces codes plus ou moins inconsciemment, mais la question réapparaît quand les normes sont transgressées. Par exemple, une personne prenant en photo des œuvres, mais ne passant que peu de temps à les observer sera regardée d’un mauvais œil, de même qu’une personne parlant fort au milieu d’une salle d’exposition). Nathalie Heinich[3] décrit cette « barrière à l’entrée » comme « la conscience diffuse de « n’être pas à sa place », qui se manifeste dans les postures du corps, l’apparence vestimentaire, la façon de parler ou de se déplacer ». Pour dépasser ce malaise, peut-être faudrait-il alors que l’art soit présent dans des espaces qui semblent moins normés. Pour autant, il ne s’agit pas de transformer des lieux publics en musées. En effet, au cours de l’interview susmentionnée, est évoquée une exposition prenant place dans un gymnase ; mais cela n’en revient-il pas à déposséder le public qui occupe habituellement l’espace de sa légitimité à le faire, pour encore accroître les « mondes » des féru·es d’art qui se veulent « ouvert·es » ?
L’alternative serait alors de placer quelques œuvres dans des lieux de passages, tels que des photographies sur des abri-bus, des sculptures à côté de bancs publics, etc. (comme les œuvres de David Černý à Prague). S’il ne s’agit pas ici d’une pratique révolutionnaire, on voit en effet l’effort fait par l’art de se déplacer au contact du peuple, sans l’envahir en l’excluant de ses propres espaces.

Mais comment faire pour être sûr·e qu’il soit remarqué, et non confondu avec de la publicité ?
3. Taper dans l’œil pour être mieux vu
Peut-être que pour attirer les foules, même les plus réticentes, l’art devrait sortir de l’ordinaire, être singulier, remarquable, et ainsi éveiller la curiosité.
C’est encore une considération qui ne va pas sans ses limites. Il peut en effet être bénéfique d’interloquer, invitant ensuite à la réflexion, notamment pour un art qui se veut dénonciateur, politique ou subversif (on peut ici penser à la photographie Sister Sadie the Rabbi Lady de Jean-Baptiste Carhaix, tête d’affiche de l’exposition « Over the Rainbow » au centre Pompidou).

Pour autant, il ne s’agit pas de tomber dans le « choquer pour choquer ». En effet, cela n’est qu’un retour au mépris des foules incapables de dépasser les mœurs pour comprendre le message que l’on veut leur faire passer. Si l’originalité peut être utilisée comme outil ou moyen, elle ne peut être un critère en elle-même, sans quoi l’on risque de ne plus faire la part des choses entre l’utile et le vil.
4. Plaidoyer pour le « joli »
Peut-être s’agirait-il d’accorder crédit à la simple esthétique de l’œuvre. Si l’on se détachait des compréhensions profondes dont la métaphysique peut être difficile à saisir et déroutante, on pourrait estimer que chacun·e apprécie l’art à la mesure de ce qui lui plaît : les couleurs, les formats, les dessins, les matériaux, les « ambiances » de l’œuvre… Il s’agirait de favoriser un art qui touche le public par les sens et non par l’intellect. La perception de l’art serait alors très subjective et, en cela, les œuvres manqueraient de variété.
L’objection ? À ne considérer l’art que comme « ce qui est beau » ou « ce qui nous plaît », on met de côté toute sa dimension politique. Non seulement un art qui se veut dénonciateur ou révélateur n’est pas forcément agréable à regarder (les photographies de la misère faites par André Papillon par exemple ; la question de l’esthétique dans les représentations de la souffrance mérite d’ailleurs bien plus qu’une parenthèse). De plus, la question des goûts est elle aussi ancrée socialement. Selon Nathalie Heinich[4], chez Pierre Bourdieu, « l’illusion du goût pur et désintéressé, ne dépendant que d’une subjectivité et n’ayant pour but que la délectation, […] se trouve mise à mal par les concepts de distinction et de biens symboliques. » Ceci signifie que nos préférences esthétiques sont elles aussi influencées par notre position sociale. N’ayant pas accès aux mêmes choses, nous n’en avons pas la même appréciation. Si l’on s’en tient au critère du «plaisir», l’art contemporain risque donc de rester l’apanage de la bourgeoisie. Cette dernière, en maîtrisant les codes et les règles esthétiques, est en effet plus encline à en apprécier le résultat.
5. Ouvrir les vannes de l’interprétation
L’un des outils que l’on propose d’inviter à la discussion est celui de la libre compréhension des œuvres. Bien sûr, cela ne suppose pas de déposséder totalement l’artiste de son travail et de lui attribuer une démarche qui n’est pas la sienne (on aurait du mal à dire des peintures de champs de Van Gogh qu’elles dénoncent l’installation des méga-bassines). Toutefois, le public peut se réapproprier l’art en ne se sentant pas obligé de lire une page d’explication pour comprendre chaque œuvre, mais en les faisant entrer en résonance avec sa propre histoire, ses propres idées, son imaginaire etc. Ce serait également un moyen d’ouvrir la discussion autour des œuvres ; le rapport à elles deviendrait moins contemplatif que participatif.

Vincent van Gogh, Champ de blé avec cyprès (Londres), 1889, huile sur toile, 72,1 × 90,9 cm
Ainsi, au Palais de Tokyo, on passerait par des médiateur·ices culturel·les qui seraient accompagnateur·ices plutôt qu’interprètes, et le lien se ferait plus horizontal (contrairement à la démarche d’expliquer une œuvre, qui est très professorale et peut faire naître un sentiment d’infériorité pour le public).
Cependant, il s’agit d’une vision qui est en partie idéalisée, car elle est difficile à mettre en place techniquement, à faire accepter et parce qu’elle ne résout pas complètement le problème du sentiment de légitimité, entre autres. Je me propose toutefois d’énumérer quelques critères qui me semblent essentiels aux œuvres tournées vers une telle approche :
Il faut qu’il y ait quelque chose à interpréter, c’est-à-dire quelque chose à regarder, toucher, écouter etc., (par exemple, pour la peinture, des formes à identifier). Cela suppose peut-être de limiter la folie des grandeurs de l’art abstrait qui se résume parfois à une toile blanche, ce qui engendre de la colère chez beaucoup de personnes (« on a payé cet artiste combien pour ça ? »). Il doit également s’agir d’éléments qui donnent matière à réfléchir sans avoir besoin de posséder, au préalable, de multiples outils interprétatifs ou des considérations métaphysiques démesurées. Pour illustrer cela, l’une des dernières expositions du palais de Tokyo, « Morphologies souterraines », semble, dans cet optique, plutôt difficile d’accès.


Il est également supposé que les artistes qui visent un public plus large prennent ce même public en compte dans leur démarche, donc qu’iels le connaissent un minimum et qu’iels freinent les inspirations qui ne sont propre qu’à leur milieu. Cette production artistique n’est pas uniquement pour soi (ou un cercle restreint / niche), elle s’extirpe de sa sphère, a la volonté de se tourner vers les autres.
En somme, l’œuvre doit pouvoir faire sens pour le plus de personnes possible. Il est, à ce titre, nécessaire que le thème de l’œuvre, s’il y en a un, soit accessible ou bien ne soit pas nécessaire à sa compréhension.
Ainsi, cette proposition selon laquelle ouvrir l’accès à l’art peut passer par la libération des carcans interprétatifs n’est pas définitive et mérite plus ample réflexion. En effet, elle est loin d’être une solution miracle, car elle n’est pas suffisante seule et comprend ses limites, ce qui semble inévitable tant le rapport entre les classes sociales et l’art est complexe.
Deux choses semblent toutefois évidentes :
– La mise à l’épreuve de ces solutions est le seul moyen d’en tester l’efficacité. Il ne s’agit donc pas simplement de reconnaître les multiples discriminations en jeu dans le milieu de l’art, mais d’avoir la volonté de lutter contre.
– Le rapport à l’art ne sera jamais égalitaire tant que nous ne détruirons pas les oppressions systémiques qui infiltrent toutes les sphères ou microcosmes de la société. Alpha Wann ne pourrait l’exprimer plus clairement dans sa chanson « Louvre » : « Mes n***** iront au musée quand ils vivront près du Louvre »[5].
[1]Palais de Tokyo, « Tu t’es déjà senti exclu.e d’un musée ou d’un centre d’art contemporain ? », TikTok, 02/10/23, https://vm.tiktok.com/ZGJ3Xo3Lb/ , consulté le 11/10/2023
[2]« Culture : l’art et de son accessibilité en 2021 », BPI France, lien, https://www.youtube.com/watch?v=2AqcpBLBpyE consulté le 09/10/2023
[3]HEINICH, N. « Sociologie de l’art avec et sans Bourdieu », Pierre Bourdieu, 2008, pp. 57-63
[4]ibid
[5]ALPHA WANN, « Louvre », Alph Lauren 3, album sorti en 2018