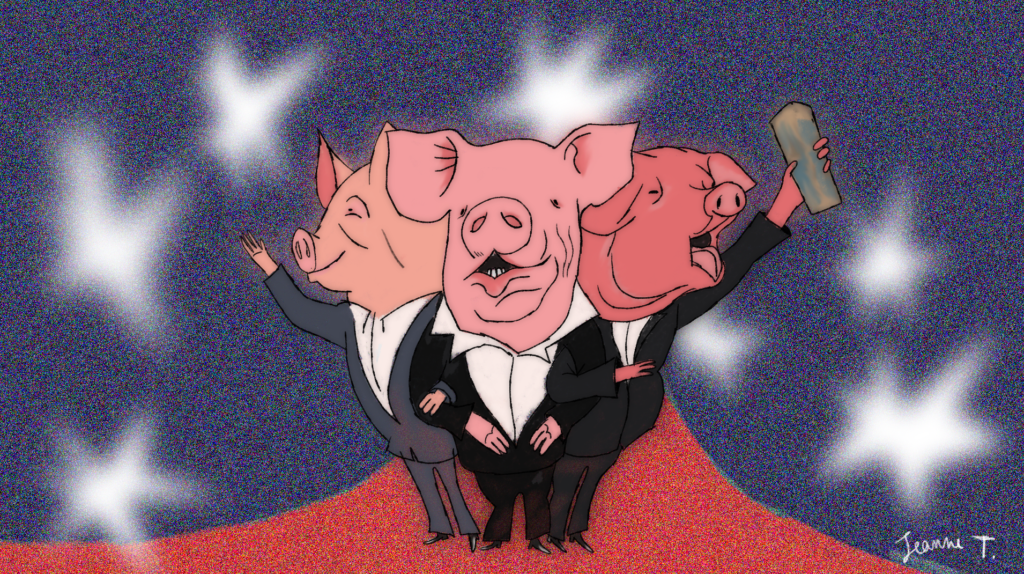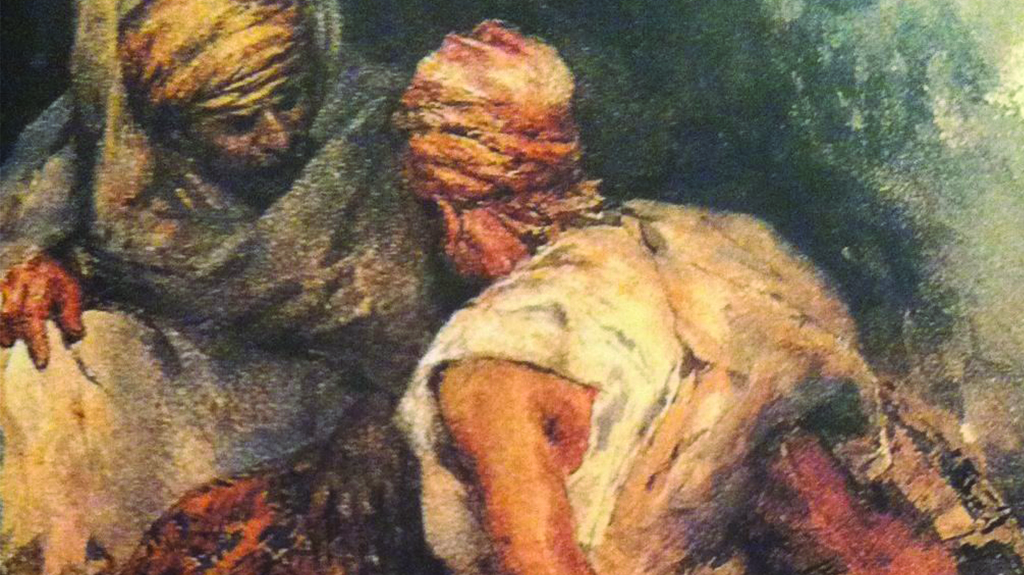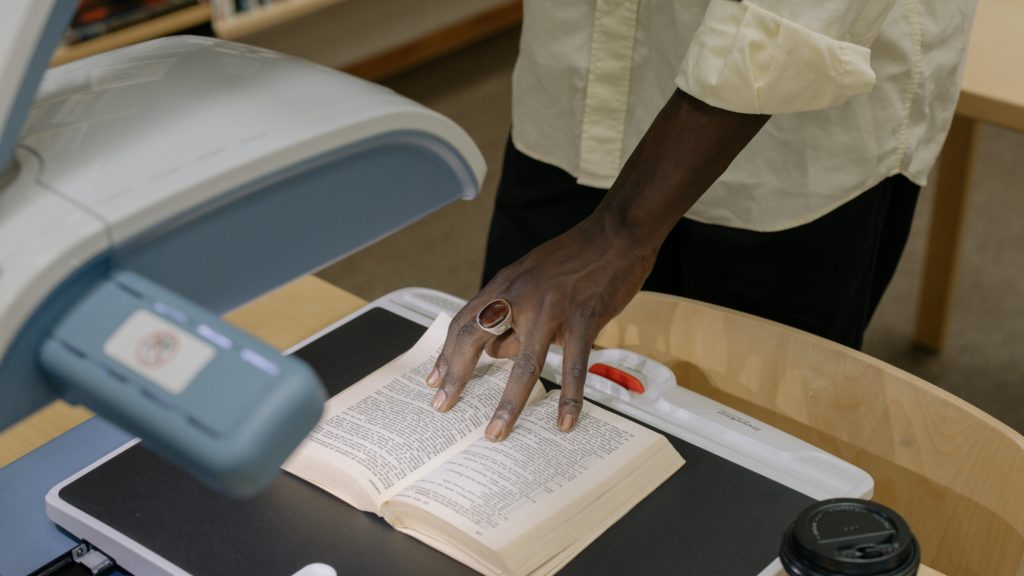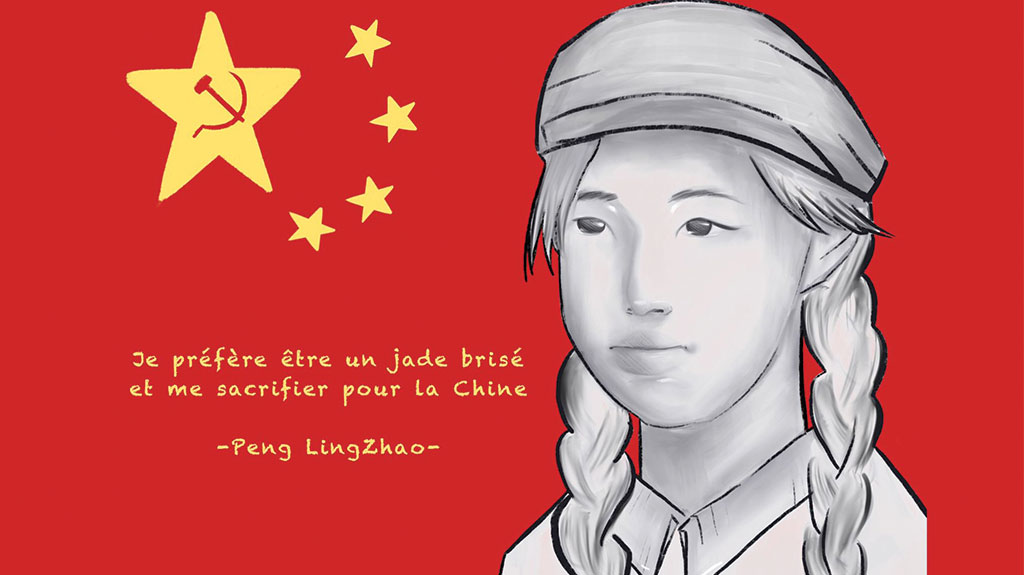La pièce est nulle hélas

Par Madeleine Gerber
Photo ©Madeleine Gerber
Publié le 31 octobre 2025
J’avais cru les recommandations. Celles de TikTok d’abord. Puis des amies, motivées par l’excitante promesse d’une grève du sexe. Puis d’une connaissance qui m’avait déjà catégorisée comme féministe, bien solide sur ses appuis. Je suis donc allée, un samedi soir pluvieux, au Théâtre de l’Atelier dans le 18e pour voir La chair est triste hélas. Écrit et mis en scène par Ovidie. Interprétée par Anna Mouglalis. Et comme l’indique ce titre, auquel j’ai mûrement réfléchi pendant les 1h10 d’ennui, j’ai détesté.
J’ai vu pas mal de pièces de théâtre au cours de mon humble et courte existence. Les masterclasses du Théâtre de la Tempête ont sûrement fait de moi celle que je suis. J’ai même participé, pendant plusieurs années, à des représentations au collège, au lycée, à la fac. Jamais. Et je dis bien jamais, je n’ai vu quelque chose d’aussi médiocre sur scène. J’estime, et David Hume s’en porterait certainement garant, que j’ai acquis une délicatesse du goût, quasi empirique, concernant le théâtre. Ce qui justifie la sévérité de mon jugement.
Mise en demeure
Quand je lis « mis en scène par Ovidie », je n’en reviens pas. Peut-on réellement parler de mise en scène quand des pans de rideaux de douche opaques, suspendus à intervalles réguliers, constituent l’entièreté d’un décor qui se veut moderne, hors des clous ? Quand ces mêmes bandes – comme autant de marques non subtiles d’une fragmentation (du monde, de la société, des femmes ?) – servent en réalité de support à la projection d’un power point animé. Succession indigente de vidéos sorties de banques d’images, de YouTube, de vieux films, utilisées sans droit, sans crédit, sans aucun sens du montage. Transitions fainéantes entre dix lignes de texte. Qui ne servent tout au plus qu’à illustrer un propos précédent : l’horrible expérience du gynécologue, l’horrible concours de mini miss, l’horrible façon dont les hommes, etc. Mais attention, c’est de la mise en scène de haut vol ! Images zoomées, enchaînées avec rapidité. Sur fond d’une affreuse musique funk, elle, sûrement bien libre de droit. En tant que spectatrice, je me sens insultée par ce manque de soin apporté à la scénographie.
Mais j’oubliais que c’est sûrement la géniale Ovidie (si c’est une référence à Ovide, pauvre de lui) qui a dû se creuser la cervelle pour chorégraphier les déplacements de son interprète. Hum, derrière, puis devant, puis derrière… Puis, tiens sur le bord de scène à droite pour plus d’intimité, mais pourquoi pas à gauche aussi pour une proximité avec le public, puis de long en large puis au milieu, puis oh ! Éclair ! Génie ! Derrière le rideau de douche, avec un éclairage dans le dos, de manière à… oui, c’est ça ! Créer une ombre chinoise ! Mais que tous les théâtres de Paris ferment leurs portes, Ovidie a trouvé le nombre d’or de la mise en scène. À 8 ans, avec mes cousines, nos spectacles étaient bien plus intéressants à regarder. Et nul besoin de payer vingt euros la place au balcon.
Chair et peau de chagrin
À la sortie du théâtre, se trouvait un stand permettant, à qui le voulait, de se procurer le texte de la pièce. Avec mes amies, nous sommes tombées d’accord : il aurait été préférable de lire ces mots, plutôt que d’assister à un seule en scène qui n’apporte aucune plus-value. Ou du moins, rien d’autre que la voix éraillée d’Anna Mouglaglis, dont chaque fin de phrase dans les graves aura eu le mérite de susciter les rires, là où les mots n’y parvenaient pas.
Un livre, donc, qu’il aurait été bien plus facile d’abandonner au bout de quelques pages, plutôt que ce satané balcon où l’on ne sait plus très bien si l’on joue à saute-mouton ou si l’on cherche sa place. À l’image de la mise en scène, le texte est d’une pauvreté affligeante. Le titre me vendait du rêve, des bons et beaux mots, une douceur, une réflexion et une sensibilité. Au lieu de quoi, j’ai dû me contenter d’un ton railleur, une fausse gouaille, des « putain » et des « baisers » en guise d’anaphore. La radicalité de surface aurait pu être un réel parti pris, sans la dédramatisation de fin à base de « je déteste pas les hommes ». Morale à deux balles, ouverture étrange sur l’égalité laissée en suspens, pour donner l’impression au·à la néophyte d’avoir assisté à quelque chose de grand.
On n’en saura donc pas plus sur cette fameuse grève du sexe, tout n’est qu’anecdotes impersonnelles et prémices de réflexions, bouts de pensées comme autant d’autocitations. Un petit côté à la Robert Bresson dans ses Notes sur le cinématographe à coups de « Le cinéma n’entre pas par la porte, mais se faufile par la fenêtre[1] ». Sauf que dans son cas, j’ai quand même terminé le livre.
Je vous laisse donc ici la meilleure punchline de la pièce, pour vous épargner effort et déception. « Les mecs de gauche baisent comme les mecs de droite ». Révélation ! À vous la dissert.
Une place au soleil
Je pensais être le public cible, il s’avère que ce n’était pas le cas. Peut-être que quand on a trop lu de livres féministes, qu’on a trop écouté de podcasts, qu’on a trop eu de discussions enrichissantes avec des amies, qu’on a trop vu de vidéos ou de TikToks traitant d’un nouveau point intéressant sur la folle histoire du patriarcat ; eh bien peut-être qu’on n’a pas besoin de ce texte. Voire que cela nous agace d’assister là au déroulement de réflexions faites et refaites. De raisonnements à peine esquissés. Quand on se sait entourée de féministes amies, qu’on se sait comprise, pas besoin d’entendre d’autres femmes rire de l’inexistence de leur plaisir sexuel avec les hommes, pour se sentir un peu mieux.
N’en déplaise à ma propre sensibilité, la pièce a plu. J’entendais des rires s’élever depuis le parterre (la connexion avec la comédienne se trouvait sans doute décuplée par un contact visuel et une réelle proximité). De nombreuses femmes se sont levées pour ovationner (ovidietionner). J’en conclus donc que le monologue les a touchées, surprises, questionnées même. Confirmation rassurante sur certaines pensées qui leur effleuraient parfois la conscience au cours de leur vie de femme hétérosexuelle. Ou bien– comble du drame – révélation pure et simple. Mots mis sur des émotions, des sensations éprouvées. Ce manque de plaisir, cette soumission, cette douleur. Cette condition de femme objet ou de prostituée gratuite qui donne sans rien (ou si peu) recevoir en retour.
Ovidie aura su parler aux cœurs de ses semblables, enchaînées dans une sombre caverne, celle de la servitude qu’elles ont toujours connues. La chair est triste hélas, comme raie de lumière et promesse d’un ailleurs, d’une libération, d’une vie autre. Référence flatteuse à Platon, qui rappelle en nous le pouvoir de l’art, peu importe sa qualité. Ici la littérature, dont s’empare le théâtre, aura participé, un tant soit peu, à l’éveil féministe de certaines d’entre nous. Féminisme qui s’ignore, se renie souvent lui-même ; les étiquettes comme celle-ci font toujours peur. Être vue comme l’hystérique, la moche, la mal-baisée. « Mais on n’est pas mal baisée parce qu’on est féministe. On est féministe parce qu’on est mal baisée ». Et c’est pas de moi, c’est d’Ovidie.
[1] Cet aphorisme n’y figure pas je crois (et j’espère), je viens de l’inventer.