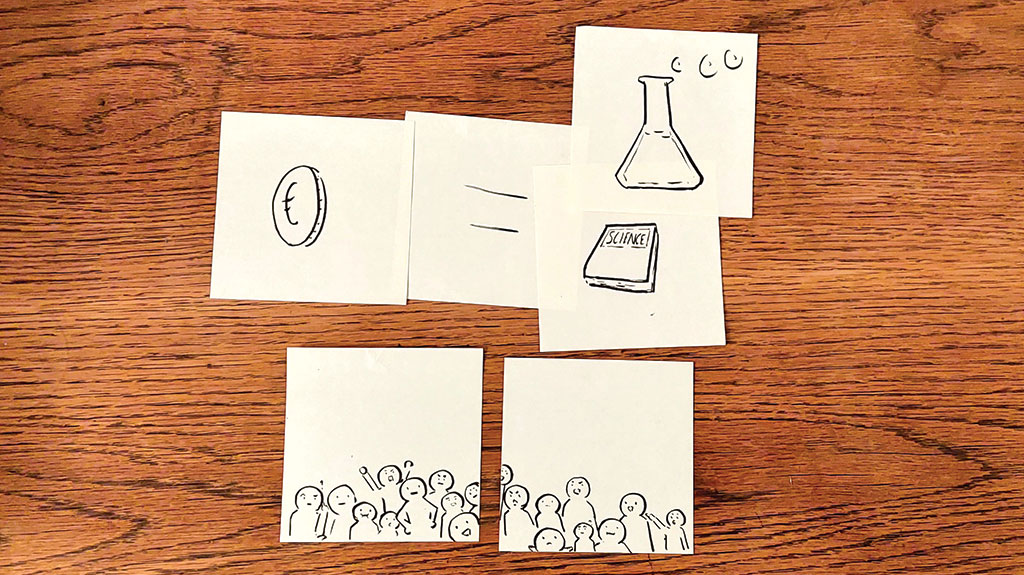On n’oublie pas, on ne pardonne pas

Par Julia Mouton
Photo DR (affiche du film Nos Frangins de Rachid Bouchareb)
Publié le 2 décembre 2023
Les Algérien·nes du 17 novembre 1961, Zyed, Bouna, Adama, Rayana, Nahel… Jusqu’où peut s’étendre cette énumération funeste ? Comment penser la lutte au sein de ce continuum de violences policières ? Il semble primordial de garder les mort·es à l’esprit.
Malik Oussekine a été tabassé à mort par la police il y a bientôt 37 ans, dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986. Au cours de cette même nuit, un second jeune homme a été lâchement assassiné par un représentant des forces de l’ordre. Il s’appelait Abdel, il était « l’autre » de cette nuit sanglante, celui dont a été tu le meurtre pour ne pas transformer en insurrection une colère déjà endeuillée.
Avec Nos Frangins, Rachid Bouchareb réveille les fantômes d’une institution qui étouffe la vérité autant qu’elle étouffe la population.
La mémoire au cœur des luttes
L’écho qui résonne dans plusieurs interventions, ayant eu lieu lors des 40 ans de la Marche pour l’égalité et contre le racisme[1], c’est le regret de la manière dont cette mobilisation historique a été écartée de l’histoire de France.
En effet, comment mener une lutte à laquelle est refusée tout ancrage historique, à laquelle sont déniés ses moments les plus féconds ?
Car la mémoire sert non seulement à honorer, mais aussi à raviver et à retracer.
La question se pose aussi, bien que de manière plus funeste, pour Rachid Bouchareb.
Nos Frangins rouvre les plaies de cette sombre nuit de décembre, nous montrant qu’elles sont en fait bien plus profondes. La manière dont le meurtre d’Abdel Benyahia a été soigneusement mis de côté en dit pourtant long sur cette vieille rengaine des « bavures », qu’il faut essuyer avant qu’elles ne mouillent le beau monde.
Rien de nouveau à dénoncer : ni l’absence de justice, ni les rechignements à établir la vérité des faits. Cependant ici, il s’agit tout simplement de reconnaître qu’il y a des faits.
L’oblitération reste de mise aujourd’hui, et le film de Rachid Bouchareb en témoigne peut-être malgré lui.
La série Oussekine, diffusée sur Disney +, évoquait brièvement, au cours d’un dialogue entre le ministre de l’Intérieur et un inspecteur, la manière dont ce « deuxième » meurtre serait facilement étouffé. Nos Frangins a au moins le mérite de ne pas simplement en faire l’occurrence, mais d’avoir la volonté de mettre les deux en parallèle.
Reste toutefois le sentiment que le meurtre d’Abdel Benyahia est « secondaire ». On peut supposer que c’est une maladresse de réalisation, et que, trouvant plus de matériaux pour documenter « l’affaire Oussekine », Rachid Bouchareb a été conduit à la documenter d’une manière plus appliquée. Nous pourrions aussi émettre l’hypothèse, plus généreuse, qu’il s’agissait de nous faire ressentir cet oubli. Peut-être que la timidité avec laquelle est évoquée la disparition d’Abdel se veut sincère : voilà comment on a fait d’un meurtre un « autre évènement », un fait divers.
Quoiqu’il en soit, la brèche est là, et ce film nous rappelle de ne pas être passif·ve face au souvenir qu’on nous refuse. On ne peut s’en tenir à rappeler ce que l’on a bien voulu nous dire, il faut aussi soulever les tapis et remuer la poussière. Aussi paradoxal cela puisse-t-il paraître, notre mémoire collective ne doit pas se donner pour limite ce dont elle se souvient. Cette mémoire est aussi faite des oublis, des non-dits.
« Silence, on tue »[2]
Comment penser les violences policières sans penser le mutisme ?
La manière dont l’histoire d’Abdel Benyahia a été laissée de côté, doit beaucoup aux autorités, au sein desquelles plus l’on monte en grade, plus l’on se protège, plus l’on ignore.
Le rôle de l’Inspection Générale des Services en devient ironique. Il s’agit d’enquêter pour savoir ce qu’il faudra cacher. Nos considérations sur cette institution sont alors ambivalentes.
Inefficace, au vu de l’« indéniable distorsion entre le nombre de plaintes déposées pour des faits allégués de violences policières et le nombre de sanctions prises pour ces mêmes motifs »[3]. Mais incroyablement performante tant elle fait preuve d’habileté à dissimuler l’éléphant dans la pièce.
Ce qui est criant, tant dans la série Oussekine que dans Nos Frangins, c’est qu’une relation presque paternelle unit le ministre de l’Intérieur, Charles Pasqua, et l’IGS. Ce lien de parenté traverse les temps: Laurent Bonelli souligne que la « relation d’interdépendance négative»[4] unissant gouvernement et forces de l’ordre semble de plus en plus étroite, au regard notamment de la forte réception des revendications du corps policier.
L’omerta, voilà qui semble être l’apanage des organisations mafieuses, et qui est pourtant l’un des ressorts du corps policier. Plus efficace que casque et bouclier, plus puissante que les tirs de LBD (même à trois mètres). Mais ce qui est écrasé par les grandes bottes de leur mutisme, ce n’est pas que la justice, c’est aussi le deuil des familles.
Que faire des familles ?
Au cours de la table ronde au sujet des « femmes dans la marche », Salika Amara, Nacira Guénif-Souilamas, Djida Tazdaït et Nesrine Slaoui évoquent la manière dont les mères sont blâmées du sort de leurs enfants[5]. La peine est triple: se voir arracher sa famille, se voir refuser vérité et justice, se voir présentée comme responsable.
C’est là un autre rouage de ce système de violences, de cette violence systémique : décrédibiliser les victimes, leur jeter l’opprobre. De la même manière qu’il est dit de la mère de Nahel qu’elle n’a pas su veiller sur son fils, il est dit de Malik qu’il était risqué de l’autoriser à sortir malgré sa dialyse, et au père d’Abdel qu’il devrait mieux éduquer ses fils qui troublent l’ordre public (Abdel séparait une bagarre quand un policier lui a tiré dessus).
La culpabilisation s’ajoute à l’absence de réponses. Ce néant, ce refus, semble être un mur auquel ont fait face tant la famille de Malik que celle d’Abdel, pour laquelle on estime qu’il vaut mieux laisser passer quelques jours avant de leur annoncer la mort de leur fils, afin que la première affaire se tasse. Il est dit blessé, avec impossibilité de lui rendre visite. La famille n’est pas considérée comme victime, mais comme dommage collatéral. Elle est celle à qui il va bien falloir le dire, mais dont la présence est tout de même gênante. Elle est en trop dans l’équation du silence.
Les familles sont un problème à résoudre, une crise à gérer, parce qu’elles demandent des réponses, et parce qu’elles pleurent leurs mort·es. Et c’est précisément la combinaison de ces deux éléments qui met dans l’embarras. Il ne suffit pas de savoir. Il ne suffit pas de regretter. Il faut dire, pour honorer la mémoire. Parce que ce ne sont pas que des corps tombés, mais des fils, des filles, des des ami·es, des frangines et des frangins.
Penser les mort·es
Quand elles s’interrogent ensemble sur les luttes sociales, Judith Butler, Hourya Bentouhami, et Elsa Dorlin évoquent la question du deuil, et celle, plus précise du comptage des mort·es.[6]
Les colleuses féministes font par exemple le choix d’afficher noms et/ou âge des victimes de féminicides sur les murs. Le compte Instagram Simone Media (@simonemediafr) procède, quant à lui, fréquemment à la publication du nombre de féminicides ayant eu lieu depuis le début de l’année en cours.
Il est en effet important de ne pas présenter les victimes comme ayant un destin tragique, personnel, ou comme étant décédé·es accidentellement. Le système qui les conduit à la mort ne doit pas être évacué de la tristesse ; la colère et la lutte ont également leur place.
Mais cela ne résout pas entièrement la question du traitement de la victime en tant que personne propre.
Bien qu’il ne s’agisse pas de dissimuler la responsabilité des autorités derrière la peine, il paraît également injuste, pour les proches des victimes notamment, de n’en faire qu’un chiffre qui vient s’ajouter à une longue liste, bientôt remplacé par un +1.
Comment, dès lors, traiter les mort·es dans leur individualité, sans les isoler ?
Nos Frangins semble apporter une contribution à cette réflexion. Wabinlé Nabié, dans le rôle du gardien à la morgue, s’adresse aux deux jeunes hommes, non comme à des corps, mais comme à des êtres. Il se présente à eux, leur donne des noms , chante pour eux, leur parle. Alors que personne ne les sait encore là – si ce n’est des autorités qui les enfouiraient dans la fosse commune si elles le pouvaient, s’opère alors une reconnaissance, une considération d’Abdel et de Malik.
Ne pas les écarter de leur propre histoire, c’est peut-être accorder une place aux mort·es dans la vie. C’est peut-être garder en tête que ce n’est pas une masse uniforme de victimes, mais des trajectoires individuelles et distinctes, conduites à la mort par un même système, qui devient d’autant plus impossible à ignorer.
[1]« Ouvrir la marche, 1983-2023, 40 ans de lutte contre le racisme», organisé par Rokhaya Diallo au centre Pompidou, les 10, 11 et 12 novembre 2023
[2]Slogan de l’une des pancartes apparaissant dans les archives utilisées dans le film
[3] Moreau de Bellaing, Cédric. « Violences illégitimes et publicité de l’action policière », Politix, vol. 87, no. 3, 2009, pp. 119-141. Moreau de Bellaing, Cédric. « Violences illégitimes et publicité de l’action policière », Politix, vol. 87, no
[4]Bonelli, Laurent. « La loi ou l’ordre ? Considérations sur la question policière », Savoir/Agir, vol. 55, no. 1, 2021, pp. 15-24.
[5]«Ouvrir la marche» journée #2, 11 novembre 2023, 15h, « Les femmes dans la marche », avec Salika Amara, Nacira Guénif-Souilamas, Djida Tazdaït et Nesrine Slaoui
[6]Lectures de Judith Butler #1 avec Elsa Dorlin et Hourya Bentouhami, 14 septembre 2023, centre Pompidou, https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/media/2jq6hex , consultée le 27 octobre 2023