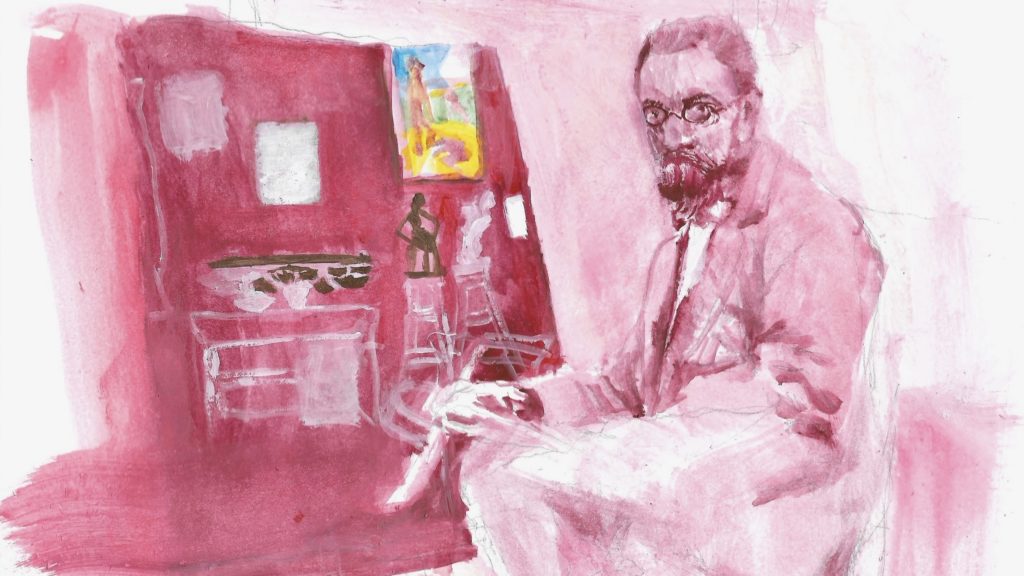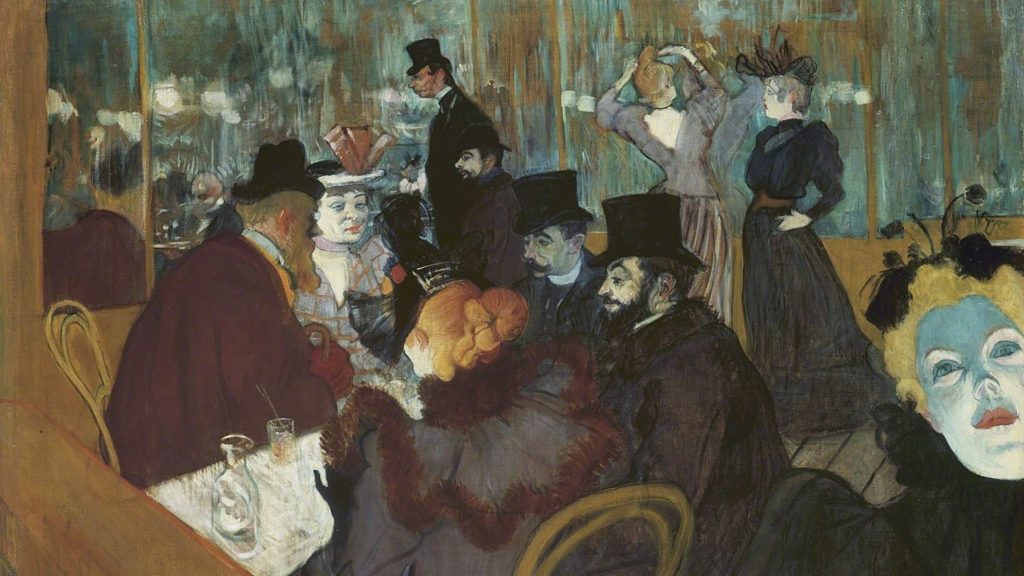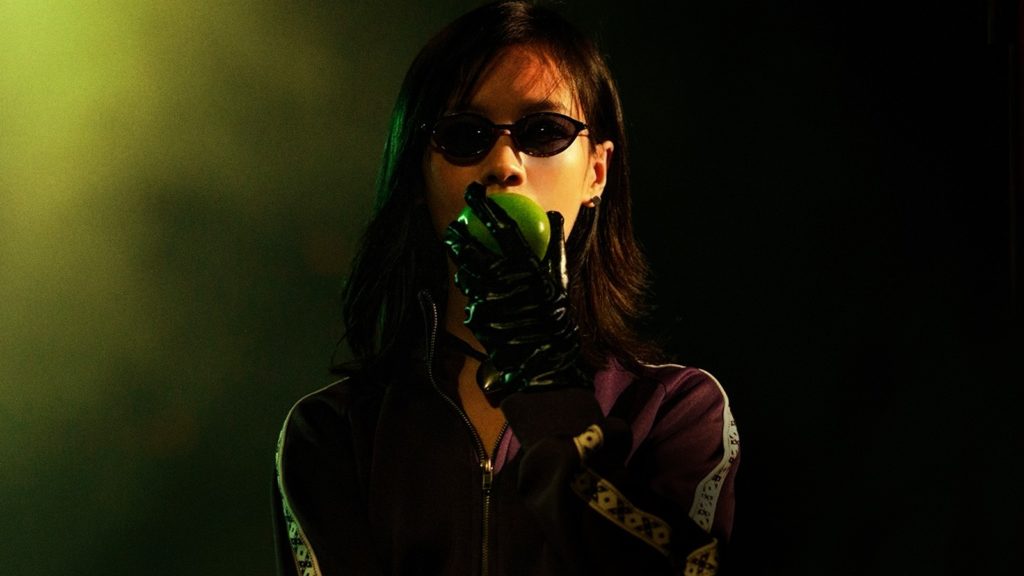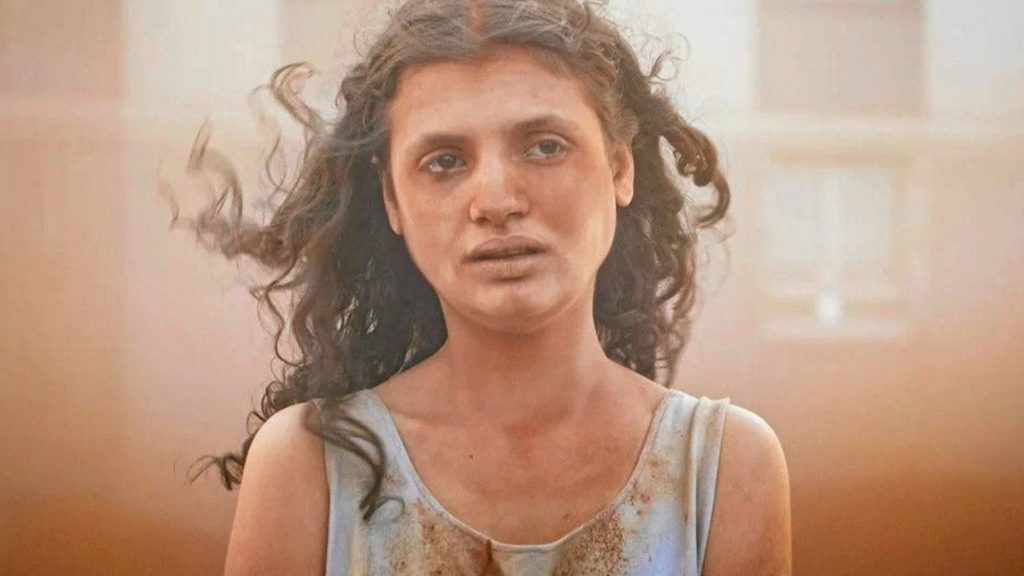PLONGÉE DANS L’ÉDITION #4 : Éditorialisation ou éditer dans l’espace numérique

Par Lou Trullard
Photo ©Pixabay
Publié le 9 mai 2025
L’éditorialisation redéfinit l’édition numérique en réorganisant des contenus pour les adapter aux supports numériques. Contrairement à l’édition traditionnelle, elle est dynamique et participative, permettant une interaction continue avec les lecteur·ices. Elle transforme des informations en formats variés pour toucher un public plus large.
L’essor du numérique a profondément transformé notre conception de l’éditorialisation, redéfinissant les normes et les pratiques associées à l’édition dans un monde de plus en plus connecté. Parmi les concepts émergents, la théorie de l’éditorialisation, proposée par Bruno Bachimont en 20071, s’est imposée comme une approche incontournable dans le domaine francophone. Ce terme désigne une activité éditoriale qui se concentre sur la production et la circulation de contenus au sein d’environnements numériques.
Cette réflexion est essentielle à l’heure où le contenu digital prend une place prépondérante dans nos vies, tant sur le plan personnel que professionnel. L’éditorialisation ne se limite pas à la simple mise en ligne d’informations, mais implique une réorganisation réfléchie des contenus, adaptée aux spécificités du numérique. Cela ouvre des perspectives inédites sur la manière dont nous consommons et interagissons avec l’information, ainsi que sur le rôle des éditeur·ices, des journalistes et des auteur·ices dans ce nouvel écosystème. Dans ce contexte, il est pertinent de s’interroger sur la définition de l’éditorialisation, ses différences avec l’édition traditionnelle et son application concrète dans le paysage numérique actuel.
Définition de l’éditorialisation
Pour Bruno Bachimont, l’éditorialisation représente un processus par lequel des informations sont restructurées et réorganisées afin de les adapter à des supports numériques2. Cette transformation est à la fois créative et technique, permettant de réutiliser des ressources initialement conçues pour d’autres formats, tout en soulignant l’importance d’adapter les contenus non numériques aux exigences des environnements numériques. Prenons, par exemple, le cas d’une recherche académique qui, traditionnellement, serait publiée dans une revue scientifique. Dans le cadre de l’éditorialisation, cette recherche pourrait être transformée en plusieurs formats : un article de blog explicatif, une infographie résumant les résultats, ou même une vidéo YouTube où le·a chercheur·euse discute de ses trouvailles de manière plus accessible3. Cette approche permet d’atteindre un public plus large et de s’assurer que l’information soit comprise par des lecteur·ices d’horizons divers.
À partir de 2008, Gerard Wormser et son équipe, ont élargi cette définition pour inclure des contenus nativement numériques4. Iels affirment que l’éditorialisation englobe les dispositifs techniques (réseaux, serveurs, systèmes de gestion de contenu), les structures (hypertexte, multimédia) et les pratiques (annotations, commentaires) qui organisent un contenu sur le Web. Cela signifie que l’éditorialisation ne se limite pas à la publication de textes, mais s’étend à une variété de médias, intégrant des éléments interactifs et multimédias qui enrichissent l’expérience utilisateur·ice. Par exemple, les plateformes comme Medium permettent aux auteur·ices de publier des articles qui peuvent être commentés, partagés et remaniés par d’autres utilisateur·ices5.
Cette capacité d’interaction et de réinvention du contenu, qu’elle soit directe ou indirecte, fait partie intégrante du processus d’éditorialisation, où chaque lecteur·ice devient potentiellement un·e contributeur·ice. Dans un sens plus large, l’éditorialisation décrit les dynamiques d’interaction entre les actions individuelles et collectives dans un environnement numérique, produisant ainsi une structure de l’espace numérique. Cela implique une hybridation entre l’espace numérique et l’espace non numérique, où la structuration de l’un influence l’autre. Par exemple, un événement en direct peut être diffusé sur des plateformes sociales, permettant à ceux·lles qui ne peuvent pas y assister physiquement de participer virtuellement et de contribuer à la conversation en temps réel6.
Différences entre éditorialisation et édition
L’éditorialisation se distingue de l’édition traditionnelle sur plusieurs points clés. Premièrement, les outils numériques révolutionnent les pratiques éditoriales, remplaçant les technologies traditionnelles de l’édition imprimée. Par exemple, des plateformes comme Canva7permettent aux utilisateur·ices de créer des contenus graphiques sans avoir besoin de compétences en design, ouvrant ainsi l’accès à l’éditorialisation à un public beaucoup plus large. Deuxièmement, l’éditorialisation s’intéresse à l’objet dans son ensemble, tandis que l’édition se concentre sur des contenus spécifiques.
Prenons l’exemple d’un livre publié par une maison d’édition. Dans le cadre d’une approche d’éditorialisation, ce même livre pourrait être décliné en plusieurs formats et plateformes : un e-book, un podcast où l’auteur·ice discute des thèmes du livre, des extraits partagés sur les réseaux sociaux, et même une série de vidéos illustrant des concepts clés8. Ainsi, chaque format enrichit l’autre et permet une expérience utilisateur·ice globale qui dépasse le simple livre imprimé. Enfin, le caractère ouvert du processus d’éditorialisation le différencie du processus éditorial traditionnel. Contrairement à l’édition classique, qui est souvent un processus linéaire et fermé, l’éditorialisation est dynamique, inachevée et collective. Par exemple, la publication d’un article en ligne est un processus continu qui peut être enrichi par des commentaires des lecteur·ices ou des mises à jour des faits9. Chaque nouvelle interaction peut modifier la façon dont l’article est perçu et compris, et même influencer son contenu. L’exemple de Wikipédia illustre parfaitement cette dynamique. Chaque article est le résultat d’une collaboration collective, où chaque utilisateur·ice peut modifier et améliorer le contenu10. Ce processus d’éditorialisation participative reflète non seulement les changements de l’information, mais aussi les évolutions culturelles et sociales qui accompagnent notre époque numérique.
L’éditorialisation dans le contexte numérique
L’éditorialisation entraîne une instabilité à plusieurs niveaux. L’accès à un article ne dépend plus uniquement de la revue qui le publie, mais également d’autres plateformes de distribution, telles que les réseaux sociaux ou les agrégateur·ices de contenu11. Un article peut ainsi devenir un objet instable et fragmenté, pouvant être modifié et réutilisé dans divers contextes. Cette nature processuelle de l’éditorialisation est liée à l’idée de fragmentation, comme l’a souligné Bachimont.
Par exemple, un article scientifique publié dans une revue spécialisée peut être repris et partagé sur Twitter, avec des commentaires et des interprétations qui varient d’un·e utilisateur·ice à l’autre, modifiant ainsi la perception de l’information. Cette instabilité ne doit pas être perçue uniquement comme une faiblesse. Au contraire, elle offre des opportunités pour enrichir le contenu. L’exemple du journalisme participatif, où les lecteur·ices peuvent soumettre des informations et des témoignages en temps réel, illustre bien ce point12. Des plateformes comme France 24 ou BBC News utilisent cette méthode pour collecter des informations lors d’événements d’actualité, intégrant ainsi des récits personnels qui apportent une dimension humaine à l’information.
Bien que l’éditorialisation semble représenter une rupture, elle s’inscrit également dans la continuité des pratiques éditoriales antérieures. Les tendances actuelles ont des racines profondes dans l’histoire de l’édition. Par exemple, l’idée de collaboration et de co-création n’est pas nouvelle ; elle peut être observée dans les salons littéraires du 18ème siècle où les écrivain·es discutaient et échangeaient leurs idées13. Aujourd’hui, ces interactions se déplacent vers des plateformes numériques, où les discussions peuvent avoir lieu instantanément et à l’échelle mondiale. Cette continuité est particulièrement pertinente dans les pratiques de publication. Les blogs, par exemple, ont été influencés par le journalisme traditionnel tout en intégrant des éléments interactifs qui permettent aux lecteur·ices de s’engager davantage avec le contenu14. Le blog « Société des Amis de la Liberté d’Expression », par exemple, permet aux lecteur·ices de commenter et de débattre des articles, créant ainsi un espace où le contenu est continuellement réévalué et rediscuté.
Conclusion
En somme, le concept d’éditorialisation offre un cadre théorique essentiel pour appréhender les pratiques éditoriales contemporaines. Il met en lumière la transformation de la fonction éditoriale, où l’éditeur·ice perd son rôle central au profit d’une approche plus inclusive et collaborative. Dans cet espace numérique, l’éditorialisation devient un processus dynamique, soulignant la nécessité d’adaptation et de réinvention des pratiques éditoriales.
À mesure que nous avançons dans cette ère numérique, il est crucial pour les éditeur·ices, les auteur·ices et les créateur·ices de contenu de s’engager avec ces nouvelles dynamiques. Cela implique non seulement d’adopter de nouveaux outils et plateformes, mais également de repenser la manière dont nous concevons et partageons le savoir. À long terme, l’éditorialisation pourrait redéfinir non seulement les pratiques éditoriales, mais aussi notre façon de comprendre et de participer à l’échange d’informations dans un monde de plus en plus interconnecté. En embrassant l’éditorialisation, nous avons l’opportunité de construire un paysage de contenu plus inclusif, réactif et dynamique, qui reflète la diversité et la richesse de nos expériences partagées.
1 Bruno Bachimont, « L’éditorialisation : vers une nouvelle approche de l’édition numérique », 2007. [Lien](https://www.bachimont.org).
2 Pour plus d’informations sur l’éditorialisation, voir [L’Observatoire des pratiques numériques](https://www.observatoire-numerique.fr).
3 Exemples de transformation de recherches académiques : [YouTube](https://www.youtube.com).
4 Gerard Wormser et al., « L’éditorialisation et ses enjeux », 2008. [Lien](https://www.gerardwormser.com).
5 Medium, plateforme de publication : [Medium](https://medium.com).
6 Diffusion d’événements en direct sur les réseaux sociaux : [Twitter](https://twitter.com).
7 Canva, outil de création graphique : [Canva](https://www.canva.com).
8 Exemples de déclinaisons de livres : [Penguin Random House](https://www.penguinrandomhouse.com).
9 Processus d’enrichissement des articles en ligne : [Harvard Business Review](https://hbr.org).
10 Wikipedia, exemple d’éditorialisation participative : [Wikipedia](https://www.wikipedia.org).
11 Agrégateurs de contenu et réseaux sociaux : [Feedly](https://feedly.com).
12 Journalisme participatif : [France 24](https://www.france24.com) et [BBC News](https://www.bbc.com/news).
13 Salons littéraires du 18ème siècle : [Encyclopædia Britannica](https://www.britannica.com).
14 Blogs et engagement des lecteurs : [WordPress](https://wordpress.com).